Seuil. Paris. 2004. 384 p.
Tandis que son homonyme Taal se démenait avec les tribus et royaumes de l'est, l'almami Umar tenait d'une main de fer le Fuuta-Jalon de ses aïeux. Réunis dans leur fief de Daara, les a haya pouvaient toujours comploter dans l'ombre et les nombreux mécontents de Timbo et des provinces maudire en secret la lourdeur de ses impôts et la cruauté de ses gardes, il n'en avait cure : son pouvoir était suffisamment solide. Son autorité s'exerçait pleinement d'un bout à l'autre du pays sauf, bien sûr, dans cette maudite forteresse de Fitaba contre laquelle, une à une, ses légions étaient venues se fracasser comme les folles vagues de la mer contre les rochers impavides.
Ce qui fait qu'en 1870, lassé par ses nombreux échecs devant la détermination fanatique des Hubbu et désireux de reconquérir sa popularité et son prestige gravement émoussés, il décida de monter une expédition dans le Ngaabu, réputé riche en or, en céréales et en cheptel, et d'attaquer le redoutable roi de ce pays, Janke Waali. Celui-ci disposait d'une puissante armée et résidait à Kansala, une ville fortifiée qu'aucun ennemi n'avait encore réussi à pénétrer.
Apprenant cela, le prétendant alfaya, Ibrahima Sori Daara, qui se morfondait dans sa capitale de sommeil en attendant que son règne arrive, éclata de rire et dit: « Cupide comme tous les siens, le soriya se rend au Ngaabu, attiré non par la gloire mais par les richesses de ce pays. Il risque de ne pas en revenir vivant: à trop écouter son ventre, on finit par avaler des braises. » « C'est de la jalousie, répondit Umar devant ses partisans. Ibrahima Sori Daara est le prototype même du alfaya : prétentieux, supérieur, maniéré, entêté. Vous verrez, dès que je serai parti d'ici, il tentera d'attaquer les Hubbu. Or, je suis l'unique rempart contre ces fanatiques, plus entêtés que lui. Il sera massacré à coup sûr s'il commet l'erreur de marcher contre eux en mon absence. »
Ces paroles résonneront plus tard dans les oreilles de leurs descendants comme la voix sans recours de deux funestes prophéties : Umar ne reviendra pas vivant du Ngaabu et Ibrahima Sori Daara perdra la vie en tentant d'attaquer les Hubbu.
La bataille de Kansala fut sans aucun doute la plus rude et la plus meurtrière de toutes celles qu'ont connues les pays des trois fleuves. La forteresse tomba en ruine et les plus braves guerriers peuls et mandingues y perdirent la vie. Mais avant de te raconter les péripéties de cette terrible tragédie, je te demande de revenir en arrière, une vingtaine d'années plus tôt.
Vers 1850, au moment même où Elhadj Umar œuvrait à la fortification de Dinguiraye, le roi de Labe, Alfa Ibrahima, appuyé par son général Alfa Moolo et une armée de six mille hommes, avait, au nom du Fuuta-Jalon, attaqué le berekolon, le rempart le plus solide du royaume du Ngaabu, et ravi la princesse de ce pays, Kumanco Saane, dont il avait fait son épouse; elle lui donnera un fils, celui qui deviendra l'illustre Alfa Yaya Jallo. En 1858, les forces conjointes de Labe et du Ɓundu avaient de nouveau assiégé Tabajan, une autre forteresse du Ngaabu, et assassiné son seigneur, Sisan Faranden, mettant Kansala, la capitale du royaume, à portée de main des convoitises du Fuuta-Jalon. Les almami de Timbo allaient enfin pouvoir investir ce bastion mandingue qui s'était libéré de la domination des Keyta et avait imposé sa volonté durant près de quatre siècles (plusieurs fois interrompus, c'est vrai, par les velléités de mainmise du Fuuta-Tooro et les nombreuses incursions du Fuuta-Jalon, entre autres) dans la vallée de la Garnbie. Le hasard allait d'ailleurs les y aider et de la plus belle manière.

Au Fuuta-Jalon comme au Ngaabu, deux branches royales alternaient au pouvoir, tous les deux ans : les Maane à Pakana et les Saane à Sama. Cette année-là, les Saane avaient volontairement gardé secrète la disparition du roi Mansa Siibo dans le but d'usurper le pouvoir. Le prince héritier de la branche des Maasinankooɓe qui attendait son tour à Pakana avait fini tout de même par l'apprendre et avait réagi violemment pour reprendre son dû. Déroutés, les Saane avaient fait appel à leur « belle-famille » de Labe qui alerta aussitôt Timbo et le Ɓundu. Voilà le contexte dans lequel se déroula la bataille de Kansala.
L'almami Umar monta une armée de trente mille soldats dont douze mille cavaliers. Il arrêta son plan de bataille et ordonna à Alfa Ibrahima, le roi de Labe, de prendre le commandement de l'expédition. Celui-ci consulta les meilleurs marabouts de sa province, tous conclurent à une victoire. Pensif, l'un d'entre eux ajouta cependant : « Oui, mais un seul d'entre vous reviendra vivant mais j'ignore s'il s'agit de toi ou bien de l'almami. »
L'expédition s'ébranla vers l'estuaire de la Gambie avec ses lanciers, ses archers, ses cavaliers armés de fusils et ses griots poussant des chants de guerre et des psaumes à la gloire de Allah. Toujours sur ses gardes, Janke Waali dépêcha un éclaireur sur les crêtes du mont Bajar. Celui-ci aperçut l'armée pullo et accourut, affolé, vers son maître. Il ramassa une poignée de sable qu'il déversa devant lui, puis une deuxième, puis une troisième.
— Que signifie ce pitoyable manège ? lui demanda Janke Waali.
— Maître, peux-tu compter ces grains de sable ?
— Non.
— Alors fuyons, les Fulɓe sont encore plus nombreux que ça !
— Plutôt mourir ! Fuir, laissons cela à ces ridicules cynocéphales de Fulɓe qui se blottissent de peur derrière leurs bêtes à cornes et prennent la poudre d'escampette dès que, dans sa tanière, le lion se met à s'ébrouer… Qui est le lion, griot ?
— C'est toi, ô roi du jour et de la nuit ! Le renard regorge de cruauté et de ruse, le renard te craint, ô maître des choses claires et des grands mystères ! La panthère qui bondit entre ciel et terre, la panthère qui arrive à déloger le phacochère et l'hyène tachetée, la panthère te craint. Le buffle, même le buffle et sa rage aux corries, le buffle te craint.
— Qui est le trouillard ?
— C'est le Pullo et son gourdin ! Le Pullo tout seul, c'est rien, c'est le gourdin qui fait sa force. Le Pullo est un misérable insecte : pieds grêles, torse de guêpe; les bras, la même taille que les mandibules de la sauterelle ! Pardonne-moi, ô tonnerre, de m'être égaré. Ils n'ont qu'à valoir tous les grains de sable de l'univers, ils détaleront aussitôt que tu ouvriras la bouche. Tu verras, tu n'auras même pas besoin de gaspiller tes balles sur ces misérables individus.
— Chante mon nom, griot, mais avant, sers-moi à boire !
Les Fulɓe, avec une foudroyante impulsion, se ruèrent dans les cités du Ngaabu. Ils asservirent des milliers d'hommes et de femmes. Ils profanèrent les idoles et les forêts sacrées, démantelèrent les tatas et les hauts-fourneaux, firent fuir les soldats, firent sauter les poudrières et empoisonnèrent les puits. Les pays des trois fleuves n'avaient jamais vu un tel désastre. Dans cette tristesse, dans ce tableau détrempé de larmes et de sang, de fumées et de cendres, on vit des saints marabouts blasphémer et de vaillants soldats perdre l'esprit et retourner leurs armes contre eux-mêmes. Janke Waali regarda ses habitations en ruine et ses greniers calcinés puis se tourna vers son griot.
— Tu as vu, griot ?
— J'ai vu !
— Qu'est-ce que tu as vu, griot ?
— J'ai vu ce qu'ont fait les Fulɓe. Entre eux et les criquets, je préfère encore les criquets : certes, ils sont moins nombreux mais ils sont plus nuisibles encore.
— Tu crois comme eux que Janke Waali est vaincu, c'est vrai ce que je dis, griot ?
— Celui qui vaincra Janke Waali ne peut émaner de la race mortelle des hommes encore moins de ces vagabonds de Fulɓe gringalets qui tiennent à peine debout sur leurs jambes. Ces gens sont des mangeurs de fonio et des buveurs de lait. Comment veuxtu qu'ils viennent à bout d'un grand gorille comme toi, repu d'igname et désaltéré au dolo. Le canari vaut moins que le fer, tout de même !
— Que dois-je faire, griot ?
— Ce que feraient ton père et ton grand-père s'ils se pavanaient encore sur terre !
Janke Waali rassembla sa famille et son dernier carré de fidèles et se barricada dans Kansala. Ceinte d'une muraille de pierres haute de la taille de cinq adultes, la cité s'avéra très difficile à prendre. Avec ses fusils, ses catapultes et ses frondes; ses jets de flammes et ses marmites de résines bouillantes, Janke Waali repoussa un à un les assauts des Fulɓe en vociférant des injures et des malédictions :
— Héritez plutôt de votre maigreur et de vos poux ! Le Ngaabu est mon legs à moi, le Ngaabu n'est pas fait pour vous, race de bâtards, sans père et sans demeure !
De l'autre côté des murailles, au milieu des canonnades et des volées de pierres et de flèches enflammées, les griots des almami répondaient avec le même véhément dédain :
— Tes cris n'impressionnent que tes sordides masques ou alors les serpents, les albinos et les chiens noirs que tu as coutume de leur sacrifier. Certainement pas de nobles Fulɓe ! Nous connaissons ta race de hâbleurs ! Les cantines dont vous vous vantez ne contiennent que des têtes de poissons. Nous allons abattre tes murailles et t'obliger à embrasser la foi, grossier païen !
— Plutôt mourir que d'entrer dans votre religion de pouilleux et de mendiants ! Éloignez-vous de mes terres, abjects noircisseurs de planchettes !
— Tu ne veux pas profiter de la chance qu'on t'offre pour te délivrer de la suie de jurons et de péchés qui encrasse ta pauvre âme ? Eh bien, nous allons t'enchaîner après avoir brûlé ta cité et nous te conduirons à Timbo pour que tu nous portes sur le dos et pour que tu laboures nos champs.
— Les dieux en créant le monde n'ont pas prévu ce jour-là où Janke Waali besognerait pour une horde de vachers aux guenilles sentant le fumier et aux dents pourries par le taro chaud !
— Tu n'en as plus pour longtemps à fanfaronner, Mandingue ! Race de démons et de reptiles puants ! Nous allons bientôt arracher ton esprit des marais stagnants dans lesquels la punition divine l'avait engoncé. Mort à toi et à tes abominables fétiches !
— Vous, les gardiens de vaches. Moi, le seigneur mandingue !
— Toi, l'immonde païen ! Nous, les doux martyrs de la noble cause !
— Chiens errants! Que les dieux fassent pleuvoir les épidémies et les foudres sur vos villages et vos mosquées !
Le Serer a raison : « Entre le Mandingue et le Pullo, c'est comme entre l'eau et le feu : les méfaits de l'un égalent la nuisance de l'autre. » La bataille de Kansala fut sanglante dans un camp comme dans l'autre. Le désastre fut tel que la capitale du Ngaabu changea de nom dans la bouche de la postérité pour porter celui de Touraban, ce qui, en mandingue, veut dire l'« extermination de la race ». Comme pour Samba Gelaajo, les scribes du Fuuta-Jalon et les griots mandingues y ont consacré de très belles épopées. En prêtant l'oreille, on peut, de notre époque, entendre les joueurs de kora fredonner cette complainte :
C'est ici que le long fer noir
Afini les hommes
Ceux qui égrènent le chapelet
Et ceux qui manient la gourde d'alcool
Se sont mariés avec la mort ici
C'est ici le Kansala de l'extermination… 1
Au bout de trois jours de siège, les Fulɓe décidèrent d'en finir. Ils firent entrer en jeu les colonnes gardées en réserve au pied du mont Bajar. Malgré les balles et les résines bouillantes, ils arrivèrent à franchir les murailles et à pénétrer dans la cité, fusillant et dépeçant avec une furie insoupçonnée. Sentant la défaite, Janke Waali se hissa sur le toit le plus haut de la ville et s'écria :
— Maudits Fulɓe ! Vous avez vaincu Kansala mais vous ne la gouvernerez pas ! J'ai demandé à mes gris-gris et à mes masques de vous maudire : Vous mourrez tous avant ce soir !
Et il fit sauter ses poudrières au milieu de ses épouses et de ses soldats. La fine fleur de l'armée pullo qui avait réussi à s'introduire dans ses palais ou à s'agripper à ses murailles périt avec lui.
Ce fut une malédiction étonnante dans son accomplissement et à peine différée dans le temps. Certes, ils ne moururent pas tous avant le crépuscule. Mais une semaine plus tard, alors que, sur le chemin du retour, ils escaladaient le mont Bajar, avec leur butin en or et leurs quinze mille esclaves, ils périrent pour la plupart d'une foudroyante épidémie de fièvre jaune. On offrit à Birom le privilège de se faire enterrer tout près de l'almami Umar.
Dooya Malal et Bookar Biro pleurèrent pendant des jours. Moodi Paate, le fils ainé de l'almami, sécha leurs larmes et dit :
— Ils ont été proches dans la vie, maintenant, les voilà proches dans la mort… Ton père a été d'une parfaite loyauté avec le mien, Dooya Malal. J'espère que tu en feras de même quand, bientôt, mon tour sera venu de le remplacer.
— Rien de plus incertain que l'avenir, répliqua sombrement Bookar Biro. Qui sait si les murailles de Timbo seront toujours là et si nous serons encore en vie ?
Mais Dieu, dans son extrême magnanimité, se porte, sans faute, au secours des innocents ! Dooya Malal, les princes Moodi Paate et Bookar Biro, Alfa Ibrahima de Labe et son général Alfa Moolo furent du petit lot des rescapés. Le roi de Labe nomma son général gouverneur des terres nouvellement conquises avec l'arrière-pensée d'épauler davantage Timbo dans son épuisant combat contre les Hubbu. Ces fanatiques religieux ne se suffisaient plus de brailler leurs psaumes et de repousser avec furie les armées des almami. Dorénavant, ils sortaient souvent de leurs prières et de leur forteresse de Bokeeto pour se muer en véritables bandits de grand chemin, qui coupaient les routes de Sierra Leone, ratissaient les pays soussous du Firia et du Solimana et terrorisaient les provinces de Timbo et de Foode-Hajiya. Cela gênait considérablement et le mouvement des troupes de Samori Touré et le commerce des Anglais. Ceux-ci, qui tenaient à leurs liens avec le Fuuta-Jalon, ne parvenaient plus à masquer leur inquiétude. En 1872 puis de nouveau en 1873, ils mandatèrent un certain Blyden à Timbo pour fournir des armes et exprimer leur soutien ferme contre la sédition des Hubbu. Blyden fut d'autant plus favorablement reçu que la mort de Umar, conjuguée à la pression de plus en plus forte de ces derniers, favorisait à Timbo une atmosphère de consensus et de réconciliation. Avec l'aide de la province de Labe, Ibrahima Sori Daara réussit sans peine à lever une armée comprenant aussi bien des alfaya que des soriya. Parmi ces derniers, Bookar Biro, le propre fils de Umar, accompagné de son fidèle Dooya Malal. Il marcha sur Bokeeto, la capitale des Hubbu, vers les premiers jours de 1873. Mais, prévenus de son arrivée imminente, ceux-ci se dispersèrent dans les montagnes et les forêts du Fitaba, le laissèrent avancer le plus profondément avant de l'encercler au bord du marigot Monguédi. L'almami fut capturé et ses soldats mis en déroute. Abal le désarma, jeta sa couronne par terre et lui intima l'ordre de se constituer prisonnier et de le suivre. En bon prince yanké [?], il refusa. Il fut tué sur place à coups de bâton, son corps protégé par la magie étant censé être impénétrable au fer. Mis au courant, son dévoué griot, Karfa, ainsi que ses quatre fils sortirent de leur refuge pour venir se faire massacrer sur son corps.

Ibrahima Sori Doŋol Fela, le frère de Umar, succéda à son homonyme de Daara comme douzième almami du Fuuta-Jalon. Souviens-toi qu'enfant, Doŋol Fela, tout comme son grand frère, l'almami Umar, avait été l'élève de Mamadu Juhe. En outre, le fondateur des Hubbu avait été aussi son beaupère puisqu'il avait épousé leur mère après la mort de leur père, l'almami Abdul Ɠaadiri. Et tu connais toutes les superstitions que drainent vos étranges habitudes de vachers ! Le beau-père est comme un père, on lui doit amour et respect. Pour rien, l'on ne peut s'opposer à la volonté du maître de Coran. Dans un cas comme dans l'autre, la malédiction divine se dépêcherait de frapper, sinon… Pour prévenir tout mauvais sort, Ibrahima Sori Doŋol Fela se détourna donc des Hubbu qui avaient été l'obsession de ses deux prédécesseurs et concentra son intérêt sur les conquêtes extérieures. Il monta, entre autres, une gigantesque expédition contre les Susu du Moreya. Mais, prévenus, ceux-ci abandonnèrent leurs cités et se dispersèrent au fond de la brousse tant que dura sa présence dans la région. Cet épisode ridicule émoussa son prestige et le déconsidéra beaucoup aux yeux des notables. Ulcéré par sa déconvenue, il développa à outrance son orgueil de soriya et son naturel impulsif et cassant. Ses relations avec le Sénat de Fugumba se compliquèrent dangereusement. Un à un, ses proches collaborateurs s'éloignèrent de lui. Ses parents et ses amis firent le vide autour de lui à commencer par ses neveux, Moodi Paate et Bookar Biro. Pour tout arranger, Cerno Abdul Wahaabi, le président du conseil des Anciens, passa du parti soriya au parti alfaya, rien que pour lui nuire.
A Labe, un événement somme toute banal allait, peu après, générer un terrible drame et ajouter à l'atmosphère délétère qui entourait son règne :
Devenu âgé et fort usé par ses excessives campagnes militaires, le prince de Labe, Alfa Ibrahima, présenta sa démission au nouvel almami et le supplia de nommer à sa place son fils aîné Moodi Aɠibu, un jeune homme érudit et pieux dont la courtoisie et le discernement contrastaient avec l'arrogance et la brutalité de son cadet et fringant cavalier, Alfa Yaya, celui-là même qui, quelques mois après son investiture se tournera contre lui et causera sa mort.
Alfa Yaya est cet enfant dont je t'ai déjà parlé, né de l'union entre Alfa Ibrahima et Kumanco Saane, cette princesse mandingue qu'il avait capturée au Ngaabu lors d'une des nombreuses expéditions qu'il y conduisit, seul ou avec les almami du Fuuta-Jalon et du Ɓundu. Un jour que Alfa Ibrahima flânait par là-bas à la recherche d'esclaves et d'or, Alfa Yaya et sa mère furent retenus en esclavage près de sept longues années. On raconte que lorsqu'il revint dans la cour de son père, vers l'âge de onze ans, il avait presque oublié la langue des Fulɓe. Est-ce pour cette raison ou à cause de l'origine étrangère de sa mère qu'il vécut une enfance relativement marginale par rapport au reste de ses frères ? Lorsque Alfa Ibrahima accéda à la tête de la province, lui, c'est le district de Kaade, le plus périphérique du Labe, qui lui fut alloué. C'était déjà un jeune homme solitaire et taciturne, peu doué pour les études mais sportif et fort élégant. Il maniait admirablement le fusil et la lance et pouvait rester des journées entières sur le dos d'une jument. Coléreux et impulsif, il avait peu d'amis et passait l'essentiel de son temps parmi ses soldats, à se bagarrer de village en village, à extorquer les biens de ses sujets et à dépouiller les caravanes. La légende affirme que de toute sa vie il ne sourit que trois fois : le jour où il tua son frère, le jour où Timbo lui donna l'ordre d'exécuter Alfa Ɠaasimu (un ancien prince de Labe entré en rébellion et dont je te parlerai un peu plus loin) et celui où ses sbires assassinèrent Moodi Saaliwu Gaɗa-Wundu, un autre de ses frères qui lui faisait de l'ombre. Il mena une vie si rustre et causa à son père tant et tant de soucis que celui-ci s'en confia à ses marabouts et à ses devins : « C'est le seul de mes garçons dont l'avenir m'inquiète. Dites-moi ce que je dois faire pour le remettre dans le droit chemin ! — Ne vous en faites pas ! lui fut-il répondu. Sa renommée sera bien plus grande que la vôtre ! » En effet, pour des raisons que je t'expliquerai plus tard, de toutes les figures historiques du Fuuta-Jalon et alors qu'il ne fut jamais que l'un des princes les plus ordinaires de la province de Labe, Alfa Yaya Jallo est de loin le plus célèbre. Le Serer a raison et bien raison: « Dieu a créé plein de lions inconnus et plein de frêles ouistitis qui se prennent pour des lions ! » Peut-être vaudrait-il encore mieux, mon petit Pullo, supporter tes scabreuses légendes que de s'essayer au jeu tronqué et aux coulisses nauséabondes de l'histoire…
On sait rien que par la forme de son bourgeon que l'épine sera pointue… Alfa Yaya manifesta très vite un goût certain pour les fastes et pour les intrigues du pouvoir. Quand, dans son fief de Kaade, il apprit que c'était son demi-frère et aîné Aɠibu que son père avait choisi pour lui succéder, il lança, dédaigneux, à son entourage : « Cet indolent qui tient à peine debout, une plume dans la main ? Avec une lance de commandement, c'est toute la province qui s'effondrerait avec lui ! » A Kaade comme à Labe, tout le monde savait l'appétit avec lequel il lorgnait sur le trône laissé vacant par son père. Seulement il savait mieux que quiconque qu'il avait peu de chances d'y accéder. Il n'était que le troisième, voire le quatrième, dans le rang de la succession et, ma foi, chef de l'obscur district de Kaade, sa renommée ne dépassait pas encore le pourtour de la case de sa mère. Mais voilà qu'un jour, fatigué de tourner en rond autour des buissons et des singes de son lointain fief, il prit la décision de tuer son frère et de s'emparer du pouvoir. Il commença par suborner sa jeune épouse, Taibou : il la couvrit d'or et promit de l'épouser, une fois le forfait commis. Ensuite, il soudoya deux bons fusils de la garde de Aɠibu qui se tapirent un soir à l'entrée de sa concession et abattirent celui-ci alors qu'il revenait de la mosquée après la prière du maghreb.
Le secret, cependant, s'ébruita jusqu'à arriver à Timbo, aux oreilles de l'almami Ibrahima Sori Doŋol Fela. Prévenu à temps par ses très nombreux affidés, Alfa Yaya courut se réfugier dans la province de Kankalabé où, comme le voulait la coutume, l'asile lui fut accordé. Il y séjourna un bon moment jusqu'à ce que ses partisans, à coups de magouilles et de pots-de-vin, réussissent à persuader Ibrahima Sori Doŋol Fela de le gracier. Il alla s'enterrer dans son fief de Kaade où il attendit près de dix ans avant de refaire parler de lui.
Avant cela, Taibou vint l'y rejoindre pour réclamer son dû.
— Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, épouse-moi !
— Reviens le lundi prochain !
Le lundi suivant, il l'attendait au détour du chemin et l'étrangla avec une ficelle.
Vers 1873, l'almami Ibrahima Sori Doŋol Fela fut déposé au profit du candidat alfaya, Amadu.
Amadu était le frère de Ibrahima Sori Daara. Il était un jeune prince plutôt pauvre. En raison des très nombreux héritiers qu'avait laissés son père, Boubakar Bademba, il n'avait eu droit qu'à un esclave et à quelques boeufs. Néanmoins, après l'assassinat de son frère Ibrahima Sori Daara par Karamoko Abal, il avait confié à Alfa Ɠaasimu, un jeune prince de Labe, son intention de briguer le trône. « Toi, almami du Fuuta-Jalon ? lui avait rétorqué celui-ci avec un incroyable dédain. Commence d'abord par t'acheter un boubou ! » Depuis, une rancune tenace couvait entre les deux hommes. Maintenant que le hasard l'avait hissé au pouvoir, Amadu se jura de faire payer à Alfa Ɠaasimu (devenu entretemps prince de Labe après l'assassinat de Aɠibu) son incroyable mépris. Seulement, comme lui, il était du parti Alfaya, il se garda donc de l'écarter au moment de la traditionnelle valse des chefs de province à laquelle ont l'habitude de procéder les nouveaux almami et préféra attendre. Il fit bien car l'occasion d'assouvir au grand jour sa vengeance ne tarda pas. En effet, désireux de régner en maître et de faire taire toute velléité de concurrence et de contestation dans sa province, Ɠaasimu en arriva à tuer son propre demi-frère, Abdullaahi, dont la mère justement se trouvait être une cousine des almami. Amadu le limogea aussitôt pour le remplacer par Alfa Sulaymane. Mais il se garda bien de le mettre aux arrêts et de le faire condamner : il était tout nouveau au trône alors que Ɠaasimu, homme puissant dont la renommée dépassait largement les limites de sa province, restait redoutable, même dans les coulisses du pouvoir. Mais après quelques péripéties aussi mouvementées qu'alambiquées, Ɠaasimu réussit à reprendre son trône. C'est alors que Amadu eut l'idée d'envahir le pays soussou du Kolisoko ; officiellement, pour convertir les mécréants ; en vérité, pour renflouer son trésor et éventuellement profiter de l'occasion pour éliminer son ennemi. Traditionnellement, dans ce genre d'expédition, il revenait au prince de Labe d'assurer le commandement général de l'armée. Ɠaasimu fut donc chargé de réunir les armes et de conduire les guerriers. Prévenus par des colporteurs de l'arrivée imminente des armées fulɓe, les Susu, comme à leur habitude, cachèrent leurs biens et s'enfuirent ne laissant dans les villages que les vieillards et les paralytiques. L'almami partit les rechercher en vain dans les forêts et les grottes. Son dépit fut plus grand encore quand il apprit que Ɠaasimu avait profité de l'abattement général pour déserter avec ses troupes, sans doute prévenu du sort qui l'attendait. « Il s'est enfui, le maudit, dites-vous ? fulmina l'almami. Eh bien, de ce jour, il n'arrêtera plus de courir jusqu'au lieu où il doit mourir. »
Ɠaasimu traversa le Konkure et démolit aussitôt le pont qui surplombait ce grand fleuve pour protéger sa fuite. Pressé de le rattraper, l'almami traversa à la nage mais perdit une bonne partie de son armée au milieu des eaux. Il dut rebrousser chemin car, à son arrivée à Bantiŋel, il apprit que les soriya avaient profité de son absence pour prendre le pouvoir. Il abandonna la route de Labe et se dirigea aussitôt vers Timbo.
Car dès qu'il avait été destitué, Ibrahima Sori Doŋol Fela avait regagné son village de sommeil dans l'intention de préparer son retour. Il réunit autour de lui suffisamment de forces, alla à la rencontre de Amadu à Pellun-Taba, dans les environs de Timbo, le vainquit et remonta sur le trône. Pour une énième fois et, sous la pression des anciens, les deux almami furent réconciliés et la règle de l'alternance bi-annuelle, rétablie. Son retour au pouvoir coïncida avec l'arrivée à Timbo de la mission Gouldsburry. Car, mon petit Pullo, les Anglais, qui avaient déjà noué des contacts avec le Fuuta-Jalon depuis les temps de l'almami Ibrahima Sori Mawɗo, commençaient à s'inquiéter du soudain intérêt des Français pour ce pays dont les provinces les plus méridionales frôlaient presque leurs possessions de Freetown. Le docteur Gouldsburry, gouverneur de la Gambie, fut donc chargé de renouer les contacts avec Timbo et, comme on dit chez les diplomates, sonder les intentions de ses dynastes. Le 22 janvier 1881, en compagnie de son second, le lieutenant Doumbleton, et d'une centaine de tirailleurs armés, il quitta la Gambie, traversa le mont Bajar, rendit une visite de courtoisie au prince de Labe et arriva à Timbo le 23 mars. Ibrahima Sori Doŋol Fela le reçut le 30 du même mois ; il lui accorda, avec une extrême facilité et sans nullement se soucier des accords conclus avec la France par ses prédécesseurs, ce qu'il demandait: la signature d'un traité d'amitié et de commerce avec l'Angleterre. Mais l'Anglais, peu coutumier de l'esprit sibyllin et des perverses subtilités du monde pullo, commit une grosse gaffe. Excité par l'imprévisible succès qu'il venait de remporter, il fit défiler sa troupe en l'honneur de l'almami. Celui-ci vit cela comme une manceuvre d'intimidation et écourta aussitôt le séjour de son hôte. Ce qui suscitera dès lors un profond malaise dans les relations pourtant jusque-là fructueuses entre Timbo et les Anglais. Malaise dont ces coquins de Français sauront tirer le meilleur profit puisque le Fuuta-Jalon, dont les almami, surtout les alfaya, étaient plutôt sensibles au charme anglais, finira par tomber dans l'escarcelle d'une toute nouvelle colonie : la Guinée française.
Puis il vint à Timbo, sans aucun doute, le personnage le plus étrange, le plus illuminé et le plus entêté de tout le long défilé d'hommes blancs qui se fut déployé, en cent ans, dans le territoire du Fuuta-Jalon. C'était un jeune Auvergnat aigrefin et ambitieux qui, après avoir eu maille à partir avec toutes les polices de France, s'était retrouvé au Portugal où il avait fini par acquérir, on ne sait trop comment, un titre de noblesse. Son nom ? Olivier de Sanderval. Entre 1877 et 1880, Olivier de Sanderval avait installé un comptoir sur les rivières que contrôlaient alors les Portugais. C'est là que lui était venue la lubie la plus incroyable jamais entendue aux pays des trois fleuves : acheter des terres aux chefs nègres et s'offrir une vaste colonie privée. Ce projet fou possédait pourtant déjà ses croquis et ses plans, son budget et son calendrier. Il s'agissait de tracer une ligne de chemin de fer qui relierait les côtes à Tombouctou en perçant à travers les montagnes du Fuuta-Jalon pour charrier par-ci la percale et la gnôle; par-là, l'ivoire et l'or, les peausseries et la cire. Mais lis ceci, mon petit Pullo, pour te faire une idée de tout ce qui pouvait se passer dans la tête d'un tel bonhomme.
Pour pénétrer ces ténèbres que les légendes de l'Histoire vraie protègent contre notre curiosité, par des récits terrifiants, pour créer un centre français dans ces terres peu connues, je me proposais (1877) de trouver quelque part en Afrique un empire primitif où des tribus puissantes dont les maîtres et les peuples ardents à la vie, curieux sans en avoir conscience des forces de progrès qui mènent l'humanité, seraient aptes à recevoir les enseignements de notre civilisation. Je me proposais de trouver un peuple qui, vierge de nos erreurs, pratiquerait, sans hésiter, les lois toutes faites dont la découverte et la discussion nous ont coûté des siècles d'efforts. D'après les connaissances que j'ai recueillies à la côte, le Fuuta-Jalon était la contrée habitable, l'empire bien ordonné par où je devais entrer et qui pouvait servir de base à mon pouvoir 3.
Ayant eu vent de la visite de Gouldsburry, Sanderval se démena pour trouver un laissez-passer et monta aussitôt une caravane pour Timbo. Les Anglais, qui ne manquaient pas d'espions non plus, se dépêchèrent de prévenir les almami contre cet ignoble aventurier français au passé lourd et aux intentions douteuses. Ibrahima Sori Doŋol Fela le cueillit dès son arrivée et le retint de force deux longs mois. L'énergumène en profita pour sympathiser avec les notables et les princes et s'informer sur le pays. Voici ce qu'il nota dans ses carnets avant de rejoindre les côtes :
De ce premier pas au milieu des Noirs, chez eux, hommes et choses s'offraient devant moi tels que je les avais coordonnés d'après mes renseignements. La conviction s'imposa avec évidence à mon esprit que le temps des explorations était passé, l'entité nègre n'était plus à scruter, elle se manifestait clairement, les chefs étaient curieux des causes de notre force Il me suffisait de comprendre pour me faire comprendre. Il fallait sans perdre un instant organiser mes tribus, fourmilières laborieuses ou guepiers de frelons, toutes formées d'hommes proportionnés au climat et prêts à suivre nos conseils. Pour eux, nous pouvons mettre en plus grande valeur, ce riche continent où notre avenir se préparait. Le Fuuta devait être le centre à portée de la côte d'où mon action s'étendrait vers l'intérieur… Le Fuuta avait toutes les qualités que possédaient les pays lointains et il avait, en plus, ce précieux avantage d'être à notre portée 4
Son idée de chemin de fer effrayait les anciens mais semait chez les jeunes un intérêt fébrile et troublant, comme devant une femme de rêve qui attire et effraie en même temps. Les princes Moodi Paate et Bookar Biro réussirent à lever les réticences de leur oncle. Ils le persuadèrent de libérer le malheureux Français et de lui accorder ce qu'il demandait: ouvrir les portes du Fuuta-Jalon à la machine de l'homme blanc.
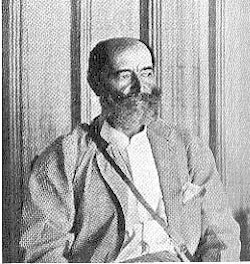
Le succès d'Olivier de Sanderval suscita les plus fous espoirs à Paris. Méfiante à l'égard de l'aventurier auvergnat qu'elle soupçonnait, à juste titre, de travailler pour son propre compte, voire pour celui du Portugal, la France décida de prendre elle-même les choses en main. Début 1881, le ministre de la Marine chargea le docteur Bayol d'approcher les almami. Celui-ci quitta Paris aussitôt. Il accosta à Boké courant mai 1881 et arriva à Timbo le 23 juin 1881. En raison de la règle de l'alternance, Ibrahima Sori Doŋol Fela venait de se retirer au profit de l'alfaya Amadu.
Le ministre se prévalait d'une lettre du président de la République française, d'une autre du gouvernement du Sénégal et d'une troisième de cheik Saad Bouh, un célèbre marabout maure ami du Fuuta-Jalon qui le recommandait chaudement aux autorités du pays. Il avait fait tout ce chemin pour proposer au Fuuta-Jalon de lui céder tous ses États vassaux de la côte et de soumettre son propre royaume sous le protectorat de la France en échange d'une solide rente annuelle et de l'appui de la marine française contre les convoitises des autres puissances européennes. Rien que cela !

L'almami Amadu refusa de le recevoir et lui fit dire ceci : « Chacun chez soi. Le Fuuta-Jalon appartient aux Fulɓe et la France aux Français. » Mais Ibrahima Sori Doŋol Fela, qui n'avait pas oublié la parade militaire de Gouldsburry, le convainquit non seulement de signer le traité pour contrebalancer les visées des Anglais mais d'envoyer un ambassadeur à Paris, en la personne d'un éminent conseiller de la cour dénommé Mamadu Saiidu Sii.
Deux traités de protectorat liaient maintenant le Fuuta-Jalon: un avec l'Angleterre, l'autre avec son ennemi héréditaire, la France. Pendant des années, les almami reçurent les rentes des uns et des autres et laissèrent leurs caravanes sillonner aussi bien les routes de Freetown que celles de Saint-Louis ou de Boké. Forts de leur réputation de renards machiavéliques et rusés, les aristocrates de Timbo surent pour un moment tirer leur avantage des cruelles rivalités qui opposaient les Français et les Anglais. « Les Blancs se déchirent pour nos beaux yeux, se disaient-ils. Eh bien, faisons croire à chacun d'entre eux que le cœur du Fuuta bat pour lui. Les choses sont très bien comme elles sont. D'un côté, gardons notre vieille souveraineté, de l'autre, empochons la rente des Blancs. Comme ça, nous pourrons acheter des armes pour écraser ces diables de Hubbu. » Car près de trente ans après leurs premières insurrections, de leur forteresse de Bokeeto, les Hubbu restaient, et bien avant la menace des Blancs et les constantes émeutes des esclaves, le souci principal des almami. Bokeeto, c'était la ville qui voyait et qui ne pouvait être vue. Elle se dressait au sommet d'un dôme entouré de failles et de vallonnements, de marais et de torrents. Le site croulait sous une végétation luxuriante de lianes et de bambous, d'osiers et de houx, d'arbres à haute futaie. Dans cette jungle infranchissable, ces satanés Hubbu avaient imaginé tout un labyrinthe de pièges diaboliques faits de piliers, de traverses et de cordages. Les armées de Timbo venaient y tomber une à une comme des masses de carpes saisies dans la nasse. Ce n'est qu'en 1883 que le Fuuta-Jalon réussit à anéantir ce mouvement qui, en trente ans, avait affaibli son économie, miné ses institutions et considérablement diminué le prestige de ses almami. Et encore, il leur fallut pour cela recourir plusieurs fois aux forces de Samori Touré.
Je te disais, il y a peu, mon petit Pullo, que lorsque après la mort de son père Abal commença à édifier Bokeeto, aux confins des pays mandingues, un certain Samori Touré commençait à y faire parler de lui. Eh bien, Samori Touré est ce colporteur mandingue qui, au moment où, de retour du Ngaabu, l'almami Umar périssait dans le Bajar, avait réussi, entre le Niger et le Sankarani, à se tailler un puissant royaume sur les décombres de l'empire du Mali. Du Ouassoulou, le berceau de son nouvel État, il se dirigea vers les mines d'or du Boûré où il se heurta très tôt aux troupes françaises de Gallieni et d'Archinard en marche vers Segu, Hamdalaahi et Tombouctou. Ce qui l'obligea à détourner ses ambitions vers le sud. Très vite, il envahit le Baleya et le Wuladu, deux petits États mandingues vassaux du Fuuta-Jalon. Ibrahima Sori Doŋol Fela protesta en vain. Samori continua sa route et investit facilement la province foutanienne de Foode-Hadjia où il se fit bâtir un tata à quelques encablures de Timbo. Cette fois-ci, la menace s'avérait bien plus sérieuse qu'aux temps de Birama Konde. Les armées de Samori étaient nombreuses et fortes. Elles représentaient incontestablement la plus grande puissance militaire des pays des trois fleuves depuis la disparition de Elhadj Umar. Et elles étaient réputées pour leur courage et pour leur cruauté. Elles massacraient tout sur leur passage, saccageaient les villages, brûlaient les récoltes, violaient les jeunes vierges, mutilaient les enfants et les vieillards, emmuraient vivants ceux qui leur résistaient, éventraient les femmes enceintes et pilaient les nourrissons. Plongés dans leurs éternelles querelles dynastiques et affaiblis par des décennies de combats contre les Hubbu, les Seediyaaɓe comprirent vite qu'ils devaient négocier. L'almami Amadu proposa d'envoyer une ambassade. Et comme dans vos sociétés d'imams et de marabouts rien ne se fait sans le gri-gri et le chapelet, ses conseillers lui répondirent : « D'accord, mais alors profitez-en pour lui offrir ce bonnet et ce destrier blancs travaillés par nos soins. S'il porte le bonnet, c'est que nous aurons réussi à annihiler en lui toute mauvaise intention à notre égard. Et s'il monte le cheval, dans le sens où se tournera l'animal, c'est dans ce sens-là qu'il poursuivra sa route. »

— Paki 5 ! s'écria Samori quand on lui présenta les cadeaux.
Puis il porta le bonnet et se hissa sur le destrier. Celui-ci hennit trois fois et se tourna vers l'est. C'est ainsi que le Fuuta-Jalon fut sauvé de la conquête et de la destruction. Samori évacua le pays et s'orienta vers les pays des Tomas et des Mande. Il fit part au Fuuta-Jalon de ses intentions pacifiques et signa un traité qui permettait à ses troupes de venir y échanger des esclaves contre des bœufs qu'elles allaient ensuite troquer contre des armes chez les Anglais de Sierra Leone. Au fond, Timbo et lui avaient les mêmes intérêts. Ils redoutaient tous les deux l'encerclement progressif de leurs royaumes par les Français qui, après Médine et Nyooro, venaient de prendre Bamako. Ils étaient tous musulmans et avaient tout intérêt à s'entendre. D'ailleurs, le marabout et le conseiller politique de Samori n'était autre qu'un Pullo originaire du Fuuta-Jalon, du nom de Alfa Usman. De ce jour, les deux royaumes échangeront des esclaves et des bœufs, des denrées et des ambassades, ils s'épauleront mutuellement et tenteront en vain de résister aux Français, jusqu'à l'effondrement final.
C'est naturellement contre les Hubbu que les deux alliés allaient se tourner d'abord. Sur ce problème-là aussi, leurs intérêts étaient absolument identiques. Car si les insurgés défiaient Timbo, ils coupaient les routes de la Sierra Leone et gênaient considérablement les ravitaillements de Samori. Après plusieurs tentatives, Kemoko Bilali, un des généraux de Samori, réussit à encercler Bokeeto. Mais les hommes de Abal refusèrent de se soumettre malgré un an de siège. C'est alors qu'il imagina le stratagème qui allait enfin avoir raison d'eux. Il scinda son armée en deux. Il demanda à la première d'alerter son collègue Lankan Nfali pour lui demander du secours tout en continuant le siège. Avec la seconde, il se présenta devant les portes de Bokeeto et feignit tout bonnement d'implorer l'asile: « Abal, ouvre-moi ! hurla-t-il. Je n'ai plus envie de me battre pour ce cruel Samori et pour ces véreux almami de Timbo. Je veux rejoindre tes troupes, je veux me battre avec toi ! » Les renforts de Lankan Nfali submergèrent Bokeeto tandis que, de l'intérieur, Kemoko Bilali retournait ses armes contre ses hôtes.
C'est ainsi que finirent les Hubbu.
« Karamoko Abal est exécuté avec ses généraux d'armée, ses frères ainsi que ses enfants adultes. Samori est obligé d'exhiber les membres de Karamoko Abal jusqu'en Sierra Leone pour assurer les caravanes que le chemin est désormais libéré du pillage des Hubbu. A cette occasion, un hebdomadaire de Sierra Leone se fait l'écho de cette victoire de Samori qui, en mettant fin aux dégradations des Hubbu, assure, selon ses termes, le progrès du commerce et de la civilisation 6. »
La disparition de Abal ne ramena pas pour autant la paix tant attendue. A la fin des années 1880, deux prestigieux marabouts allaient tenter de canaliser le mécontentement général pour abattre le pouvoir despotique des almami et résister à la pénétration européenne : le Waliyu de Gomba dans la province actuelle de Kindia et Cerno Ibrahima Ndaama dans le nord du Labe. Mais c'était juste pour la frime. Un pathétique baroud d'honneur, une lamentable pantalonnade de Fulɓe! Le destin avait parlé, ta race de bergers préhistoriques, fiérots et vindicatifs ne pouvait plus rien. La loi des nouveaux temps devait, sans faute, s'appliquer dans son univers aussi.
Revenu une nouvelle fois sur le trône en 1888 par la grâce de l'alternance, la première décision de Amadu fut de nommer un nouveau chef de province à Labe en la personne de Alfa Ibrahima Basanya, le leader de la fraction alfaya. Le turbulent Ɠaasimu mobilisa une armée et vainquit celui-ci à Bantiŋel. Amadu ordonna alors à Alfa Ceewiire, le chef soriya de Labe, de venir au secours de Basanya. Ɠaasimu fut mis en déroute, cette fois, et s'enfuit à Médine, dans le Khasso. De là, il poursuivit jusqu'à Kayes, où il rendit visite au colonel Archinard qui commandait les troupes françaises au Soudan. Celui-ci lui proposa de mettre des hommes et des armes à sa disposition pour le réinstaller au pouvoir à Labe. Sur ces entrefaites, survint le terrible carnage que les troupes d'Archinard commirent sur la ville de Nyooro. Malgré l'extraordinaire percée des Français en direction de la boucle du Niger, la plupart des Fulɓe du Haut-Sénégal restaient encore fidèles à Amadu, le fils de Elhadj Umar, qui régnait toujours à Segu. Supportant mal le joug français, les gens de Nyooro se révoltèrent contre Archinard qui signa là la première grande boucherie de l'ère coloniale.
— A voir la brutalité avec laquelle tu as émasculé tous ces hommes, décapité tous ces enfants et éventré toutes ces femmes enceintes, je ne veux plus de ton aide, colonel, lui cracha à la figure Alfa Ɠaasimu. Je rentre à Labe. Puisqu'il faut mourir, je préfère que ce soient les miens qui me tuent, ce sera plus régulier ainsi.
— Comme tu voudras, prince ! C'est à toi de savoir ce que tu veux : le pouvoir ou les mains propres.
— Je préfère vivre sans pouvoir que de redevenir prince de Labe sous ton égide. Tu ferais aux miens pire que ce que tu viens de faire. Vous, les Blancs, vous n'êtes plus des inconnus : on sait maintenant tout le volume de fiel qui dégouline dans vos coeurs.
— Arrête ton cirque, prince ! Combien de malheureux as-tu décapités pour régner sur ta province ? Et qu'est-ce qui t'a poussé à courir jusqu'à moi, sinon l'instinct du criminel ? Les almami de ton pays prennent les têtes des hommes pour de la vulgaire cochonnaille. Il suffit que vous jetiez un œil sur leur femme pour qu'ils vous la tranchent. Tu crois que je ne sais pas ?… C'est pareil pour Amadu de Segu, pour Ceebaa, pour Samori, et pour les roitelets wolof. Tous, vous êtes des bêtes assoiffées de pouvoir et de sang. Et c'est bien pour cela que nous sommes là : pour arrêter vos pitreries de Nègres !
— Vous n'êtes qu'une horde de bandits sans honneur et sans loi !
— Et vous, des peuplades primitives armées de flèches et terrées dans les grottes !
— Nous n'avons envahi personne, nous ! Nous ne tuons que pour nous défendre !
— C'est faux ! Vous tuez par instinct, par vice, par goût de la chair humaine et nous seulement pour les besoins de l'Histoire. Avoue que ce n'est tout de même pas pareil, mon petit Nègre !
Alfa Ɠaasimu maudit Archinard et s'en retourna affronter son destin à Labe. Ses ennemis laissèrent aussitôt entendre qu'il avait profité de son séjour à Kayes pour vendre le Fuuta-Jalon aux Français. Cette accusation, ajoutée à ses nombreuses inconduites antérieures, le fit condamner à mort pour intelligence avec « les païens aux oreilles rouges, les pires ennemis de l'islam ». Aussitôt arrêté, il sera fusillé en 1892 par Alfa Yaya, le nouveau prince, que, après son tumultueux couronnement, Bookar Biro installera à Labe.

Absorbés par les guerres contre les Hubbu et par leurs fastidieuses querelles dynastiques, les almami ne se rendirent pas tout de suite compte que leur sort était scellé. Ce n'est que plusieurs années après la mort de Abal qu'ils réalisèrent l'ampleur du désastre. Quand ils sortirent leur nez des forêts de Bokeeto, ils découvrirent que les Français, après le Sénégal, venaient, sans demander leur avis, de créer une colonie sur leurs terres vassales de la côte : la colonie française des Rivières du Sud, avec Conakry comme capitale et le bon docteur Bayol comme gouverneur. Hormis Boké, les Blancs y disposaient, à présent, de trois autres nouveaux forts solides et puissamment armés : Benty, Dubréka et Boffa. Les impôts qu'ils devaient verser aux almami en échange commencèrent par s'espacer puis par disparaître sans aucun motif. Pendant ce temps, venues de Conakry, de Saint-Louis ou du Soudan, les missions se succédaient à Timbo pour maintenir la pression et laisser sentir la menace. Mais ce qui aggrava davantage l'amertume des almami, ce fut la hargne avec laquelle ils harcelaient leur allié Samori Touré, l'homme qui leur avait permis de se débarrasser des Hubbu. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, il flottait dans l'esprit des Fulɓe un sentiment franchement anti-français. Des actions de représailles éclatèrent un peu partout dans le pays. C'est ainsi par exemple qu'en 1886, alors qu'il traversait le Timbi-Tunni, un ambassadeur venu de Boké, le docteur Fouque, fut pillé par des inconnus, arrêté, attaché nu à un arbre et bastonné copieusement. Il ne dut la vie sauve qu'à un notable de Fugumba qui passait par là. C'était déjà, quoi qu'il en soit, tard et bien tard. Comme une grive dans la tendelle, le Fuuta-Jalon se trouvait en plein piège, mais le Fuuta-Jalon ne le savait pas encore…
Ils se croyaient malins, tes pouilleux d'ancêtres, plus malins que tous les autres, plus malins que les Blancs eux-mêmes. Es croyaient utiliser les Français et les Anglais les uns contre les autres, continuer à empocher l'argent des uns et des autres, sans rien donner en retour. Prrr ! Ils étaient sans doute les seuls à ne pas savoir que depuis 1888, à Paris, et les Anglais et les Portugais avaient officiellement reconnu les droits inaliénables des Français sur le royaume du Fuuta-Jalon. En 1889, continuant leur politique d'encerclement, ceux-ci fondèrent le poste de Kouroussa puis obligèrent Samori à signer un traité par lequel il leur attribuait toute la rive gauche du Niger séparant ainsi définitivement les deux royaumes alliés. Repoussé vers les vastes forêts des Tomas, coupé du bétail du Fuuta-Jalon et des armureries de Sierra Leone, Samori y trépignait et exultait comme un buffle en cage. Très vite, avec leurs vieilles astuces, les almami lui trouvèrent un circuit clandestin de ravitaillement. Mais très vite, les Français le démantelèrent en construisant deux nouveaux postes sur les terres mandingues : Heremakono et Faranah.
A la fin des années 1880, la question n'était plus de savoir si les trois derniers États indépendants des pays des trois fleuves, c'est à-dire le Fuuta-Jalon des almami, le Wasulu de Samori Touré et le Segu de Amadu Taal, allaient tomber sous le joug français. Mais quand ?
Ce jour de l'hivernage 1890, Dooya Malal se trouvait à Kolen où il était venu amasser les impôts de la couronne quand mourut l'almami Ibrahima Sori Doŋol Fela. Le tambour de deuil résonna alors qu'il venait de terminer la prière du crépuscule. Il entendit distinctement les neuf frappes rauques espacées dans le temps et comprit qu'il n'avait plus une minute à erdre. Il sella aussitôt un hongre et fila sans prendre la peine de prévenir sa suite. Il savait qu'un danger imminent se préparait dans la capitale, que sitôt le défunt souverain enterré le sang coulerait à Timbo. À la mort de leur père, l'almami Umar, Moodi Paate et Bookar Biro n'avaient pas atteint cet âge infatué et consistant où l'on peut prétendre au trône. Ce n'était plus le cas. Chacun d'eux possédait maintenant la carrure, le tempérament, le nombre de soldats, les barils de poudre et le bestial appétit du pouvoir qu'il faut pour faire un grand roi, c'est-à-dire un homme peu ou prou vertueux mais craint des nobles et admiré des foules. C'étaient tous les deux des princes soriya ! Un soriya ne renonce pas au trône, on le sacre ou bien on le tue. Une fois leur oncle enterré, seul un miracle du Ciel pourrait les empêcher d'aiguiser les couteaux et de s'étriper. Il savait, lui, Dooya Malal, que ce maudit jour viendrait inéluctablement, qu'il était depuis belle lurette inscrit au Ciel. Il l'avait nettement perçu dans le regard des deux demifrères le jour où, tous les trois, ils avaient refermé la tombe de leur père dans le cimetière de Dombiyaaji. Il avait en vain tenté de calmer l'orgueil démesuré de l'un et la fougue de l'autre, le mépris de l'aimé et les ambitions précoces du cadet. Alors, il s'était résigné à se taire et à laisser la fatalité s'occuper des choses. Quelques siècles plus tôt le vieux Koiné avait fait face aux jumeaux Birane et Birom. Il avait cependant pris le soin d'amasser des armes en cachette durant toutes ces années de rancoeurs et de suspicions, de menaces et de filatures, de fébrile et angoissante attente. Car son choix était déjà fait, probablement bien avant que l'almami Umar ne les mette sur le dos d'un cheval puis les circoncise, Bookar Biro et lui. « Puisque, ce jour-là, il faudra mourir ou régner, alors je serai du côté de celui qui aura partagé mes jeux d'enfance et mêlé son sang au mien le jour où le couteau nous a rendus propres, je serai du côté de Bookar Biro. » Il s'était dit cela parce que, dans ces cas-là, il faut absolument choisir. Sinon, il les aimait bien tous les deux. C'étaient tous des fils de l'almami Umar, celui qui avait protégé et anobli son père Birom, celui qui lui avait donné le statut de prévôt et de juge et appris le métier des armes, l'homme qui l'avait traité comme son propre fils.
Oui, c'étaient, tous les deux, des soriya bon teint, courageux, susceptibles et fougueux qui s'étaient illustrés, en compagnie de leur père, sur tous les champs de bataille. Et comme tels, des teigneux, des têtes de mule, des butés, des cabochards, capables d'y laisser leur vie ou celle de leur mère plutôt que de se renier ! Ils différaient au physique comme au mental mais c'était avant tout des princes de Timbo, nés pour dicter et mépriser, se pavaner et se faire obéir ! Moodi Paate était mince, Bookar Biro, costaud. Celui-ci regorgeait de ruses et de fines subtilités, celui-là bouillonnait de colère et d'énergie. L'un avait la souplesse athlétique du félin, l'autre la force imprévisible du buffle… Le lion du Fuuta, le tonnerre de Neene Jaariwu 7, celui-là, c'était Bookar Biro ! On raconte qu'une fois il jeta une pierre à un chien errant : par ricochet, il abattit un papayer. C'était un monstre, je te dis, mon petit Pullo : du repas le plus copieux, il ne faisait que trois bouchées. Quand il grondait à Timbo, on l'entendait jusque dans les recoins de Yemberen !…
C'était écrit : ils n'étaient pas nés pour s'entendre, ces deux-là. Ils devaient se battre un jour ou l'autre. Les choses s'étaient mises à mal tourner dès leur retour du Ngaabu. Imbu de son droit d'aînesse, Moodi Paate avait accaparé à lui seul l'immense trésor laissé par son père, refusant de partager l'or, le bétail et les esclaves aussi bien avec ses frères qu'avec ses demi-frères. Il expulsa ces derniers de Sokotoro, Neeneya et Helayaa, les traditionnels fiefs des soriya, pour s'y installer avec ses laudateurs et ses gardes. Bookar Biro et le dénommé Ibrahima exprimèrent leur mécontentement un peu plus fort que le reste de la fratrie. Pour les dissuader d'aller plus loin, il fit massacrer ce dernier à coups de bâton par ses soldats et partit se réfugier dans le Labe. Sur l'intervention de l'ensemble des chefs de province, l'almami Amadu lui accorda le pardon et l'autorisa à revenir à Sokotoro. C'est vrai que, assuré d'une richesse à nulle autre comparable, soutenu par les notables, notamment par Tiemo Abdul Wahaabi, le doyen du conseil des Anciens, bien vu des Français de la côte, il pouvait se croire invincible.
Plus pauvre, moins apprécié dans les hautes sphères du pouvoir — seul le prince de Fugumba lui consentait un peu d'estime —, Bookar Biro était néanmoins craint. On le savait énergique, déterminé, ambitieux. C'était un guerrier dans l'âme qui ne se déplaçait jamais sans ses cinq cents gardes bien armés. Quand il exprima son désir de briguer la couronne, Neene Jaariwu s'arracha les cheveux et le dissuada en vain :
— Renonce, fils ! sanglota-t-elle. Efface-toi devant ton aîné ! Il a avec lui la richesse et les voix les plus éminentes du Fuuta. Ne l'affronte pas, il te tuerait ! Incline-toi pour cette fois-ci. Apprends à attendre et ton tour viendra, sûrement !…
— Mère, tu vois mon cou ? C'est là qu'il se trouve, le pouvoir. Il faudra me le couper pour m'empêcher de régner. Les dés sont jetés, mère, tes larmes n'y pourront rien. Si je tue Moodi Paate, je monterai sur le trône et tout le Fuuta verra que tu auras été une bonne mère et une bonne épouse. Si Paate me tue, il tuera mon frère Aliiyu ainsi que mon fils, Moodi Sori, et les musulmans commenceront à douter de ta bonne conduite sur terre.
— Je t'assure qu'on peut vivre très heureux sans s'asseoir sur un trône. Renonce, je t'offre deux cents vaches laitières !
— Non !
— Deux cents esclaves : cent hommes et cent femmes !
— Je suis prince de ce royaume. Je dois répondre présent quand l'heure de commander arrive, au risque de faire mentir le sang de mes aïeux…
Dooya Malal chevaucha jusqu'au matin. Il trouva Bookar Biro dans son hameau de villégiature de Caacako. Le lendemain de l'enterrement, un valet vint leur annoncer que Moodi Paate se trouvait déjà à Ɓuriya pour solliciter son investiture officielle. Bookar Biro réunit aussitôt ses troupes pour y foncer. Mais les sages de cette ville s'étaient donné le mot : quand il se présenta devant ses portes, on lui fit croire que son demi-frère avait gagné Fugumba pour y recevoir la couronne. Il appela son courrier le plus rapide : « Va dire à Alfa Ibrahima que j'arrive ! Je veux qu'il m'accueille avec le tambour royal et tout le peuple de Fugumba ! Cette couronne me revient, c'est sur ma tête qu'il doit la poser s'il tient à garder la sienne. »
Paate fut couronné à Ɓuriya et Biro à Fugumba. Deux almami pour le même trône, deux lions affamés sur la même proie ! A coup sûr, l'un devait éliminer l'autre. Dans les chaumières, les gens du Fuuta-Jalon s'étaient déjà préparés à l'avènement d'une nouvelle tragédie avant que les deux protagonistes ne convergent à Timbo avec leurs griots et leurs guerriers. Les deux armées s'empoignèrent sous le fromager dressé devant la porte ouest de la ville. L'avantage tourna vite au profit de Bookar Biro. Abandonné par ses partisans, Paate réussit à se cacher dans un grenier. Une vieille femme le dénonça contre une mule et un bracelet d'argent.
— C'est bon, admit-il, sois l'almami et moi, le grand frère de l'almami ! Laisse-moi la vie sauve que je puisse au moins adorer Dieu !
Bookar Biro était au bord des larmes, il décida d'accorder la grâce à son frère. Alfa Ibrahima de Fugumba s'y opposa de toutes ses forces : « Comment, grand naïf ?… Si tu le gracies, ne compte plus sur mon soutien, menaça-t-il. Quand la panthère est blessée, on l'achève ou l'on se prépare à sa propre mort. »
Alors, Ŋaaliba, le chef des armées, reçut l'ordre d'exécuter le malheureux avec une balle en or, la seule digne de pénétrer le corps d'un prince du Fuuta.
Epouvanté par cet assassinat, le pays se soumit au nouvel almami avec une humilité et une résignation qu'on ne lui avait jamais connues. Cependant, dans les sphères du pouvoir, les craintes et les ressentiments allaient se transformer très vite en rumeurs malsaines et en secrètes conjurations qui allaient miner le Fuuta-Jalon et précipiter définitivement sa chute. Il est vrai que le tempérament de Bookar Biro allait favoriser ce climat néfaste et l'isoler progressivement des relais traditionnels du pouvoir. Son génie fut de s'appuyer sur les jeunes, les gens de condition modeste et les esclaves affranchis; sa tragédie, sa volonté de démanteler le pouvoir fédéral, si boiteux, si vulnérable devant le péril de l'homme blanc, et d'imposer à sa place un pouvoir fort et centralisé…
Nationaliste intransigeant mais brutal, autoritaire, n'hésitant pas à aller jusqu'au bout de ses décisions les plus incompréhensibles, il s'aliéna très vite la sympathie des chefs de province et suscita de nombreuses inimitiés dans son propre camp. Aussitôt arrivé au pouvoir, il destitua tous les princes alfaya et imposa dans la moindre province les candidats soriya de son choix, sans respecter les préséances et les hiérarchies. A Labe, par exemple, il imposa brutalement son ami Alfa Yaya au mépris de l'avis fort réticent des anciens de cette ville. A Timbo, outre l'hostilité naturelle des rivaux alfaya, il devait affronter la rancoeur de ses propres demi-frères surtout celle de Abdullaahi et de Sori Yillili, qui ne lui pardonneraient jamais l'assassinat de Moodi Paate ainsi que les réticences des doyens pour la manière désinvolte avec laquelle il était parvenu au pouvoir. Son autorité ne reposait que sur deux éléments, en vérité : son courage sans limites et le soutien de Alfa Ibrahima de Fugumba. Mais très vite ce second appui allait se dérober sous ses pieds à la faveur d'une anecdote des plus dérisoires survenue en 1895.
Un notable du village de Kaala, Cerno Hamjata, possédait dans son galle 8 une jolie concubine du nom de Kumba Jiwal ainsi qu'un cheval qui faisait l'admiration de tous les bons cavaliers du Fuuta. Abusant de ses prérogatives de chef de province, Alfa Ibrahima arracha à Cerno Hamjata et la concubine et le cheval. Celui-ci s'en plaignit à la cour de Timbo. Choqué par tant de désinvolture, Biro mit en demeure le chef de Fugumba de restituer ses biens au plaignant. Alfa Ibrahima refusa. Bookar Biro prit alors la décision qui allait le mener à sa perte et ruiner le Fuuta-Jalon : il suspendit le coupable de ses fonctions et détacha les districts de Kaala et de Dalaba de Fugumba pour les rattacher directement à Timbo. Alfa Ibrahima jura de se venger et jeta, dès ce jour, tout son poids et tout son prestige dans le camp ennemi.
Le vieux renard réussit à mettre dans le coup Alfa Yaya, le roi de Labe, et une bonne partie du conseil des Anciens. Il fut décidé d'attirer l'almami dans une embuscade à Bantiŋel et de procéder à l'intronisation de son demi-frère et rival, Moodi Abdullaahi, sitôt qu'ils l'auraient éliminé.
L'almami y perdit une grande partie de son escorte mais il réussit à s'échapper et à gagner la province de Timbi-Tunni dont le roi, Cerno Maâdiou, lui était resté fidèle. Son fils Moodi Sori, Dooya Malal, son conseiller, Karamoko Dalen, son marabout et Moodi Saiidu, son secrétaire, l'y rejoignirent pour l'aider à monter une année et préparer la riposte.
Était-ce un hasard ? Beckmann, le tout nouveau commandant français de Dubréka, rôdait dans le coin. Il se fit un plaisir de sauter à cheval et de venir constater par lui-même l'état de désespoir du souverain.
— Je vous offre une colonne de tirailleurs et je vous aide à gagner Timbo et à vous réinstaller sur votre trône, majesté ! proposa-t-il perfidement.
— C'est une affaire entre Fulɓe, cela ne te regarde pas, Blanc. Je préfère être tué par mes propres parents que de demander le secours d'un inconnu qui ne cherche qu'une chose : terrasser les Fulɓe et s'accaparer le pays de leurs pères !
Le Français le persuada cependant d'accueillir deux de ses observateurs dans son escorte. Puis il se précipita à Dubréka pour adresser un rapport au gouverneur de Conakry :
Le Fuuta est au bord du chaos. L'occasion est unique pour nous. Il est temps d'arrêter de tergiverser avec les almami et de leur soumettre un ultimatum : nous ne reconnaîtrons le nouvel almami ou nous n'accepterons le retour de l'ancien qu'à la seule condition qu'ils nous autorisent enfin à établir un poste à Timbo. Il faut agir et avoir des troupes prêtes à marcher. On nous pardonnera difficilement cette question du Fuuta qui languit depuis des années. Le Commerce est désireux de nous voir profiter des événements pour établir solidement notre autorité dans ce pays
Pressé d'en découdre avec les conjurés, Bookar Biro quitta aussitôt le Monoma pour rejoindre Timbo avec son impressionnante colonne de guerriers peuls, soussous et de dialonkés.
Informé du mouvement qu'il venait d'amorcer, l'almami Abdullaahi, Alfa Yaya, Alfa Ibrahima et Sori Yillili lui barrèrent la route dans les falaises de Petel-Jiga. La bataille fut rude mais largement victorieuse pour lui. Alfa Yaya prit la fuite. Et Alfa Ibrahima de Fugumba et Sori Yillili se faufilèrent dans la brousse, déguisés en griots.
Moodi Abdullaahi se réfugia à Nunkolo. Bookar Biro se chargea lui-même de l'y chercher. Il l'arrêta mais, contre toute attente, le traita avec beaucoup d'égards et le fit conduire sous bonne escorte à Timbo, sans doute pour atténuer l'immense terreur que tous ces sanglants événements avaient semée dans le pays.
Son prestige rehaussé par cette éclatante victoire, il s'empressa de rétablir son autorité aussi bien à Timbo que dans les provinces dont les chefs furent instamment conduits à lui pour réitérer leur soumission et recueillir son pardon. Seuls Alfa Ibrahima de Fugumba, Sori Yillili et Alfa Yaya refusèrent d'obtempérer. Ils se retrouvèrent à Labe où ils prirent la décision qui allait définitivement sceller le destin du Fuuta-Jalon : faire appel aux Français pour en finir avec Bookar Biro.

Sori Yillili prit le chemin de Siguiri où stationnait une compagnie militaire du Soudan français après avoir proféré cette sinistre sentence qui reste aujourd'hui encore collée à son nom comme, dans les temps anciens, le sceau de l'infamie sur le front du criminel : « Si je fais ce que je me prépare à faire, plus personne ne parlera du Fuuta-Jalon. » Alfa Ibrahima retourna discrètement dans son fief pour mener campagne contre Bookar Biro. Car si ce dernier avait bel et bien réussi à reprendre son trône et à rétablir une autorité indiscutable, le pays profond vivait dans la terreur et dans l'incertitude. A Conakry, bien sûr, les Français étaient au courant de cette situation grâce à leurs nombreux espions et aux déclarations de fidélité qui émanaient dorénavant des différents coins du pays.
Bénéficiant désormais du large soutien des chefs de province mais plus que jamais aux aguets, Beckmann demanda et obtint du gouverneur de Conakry l'autorisation de se rendre à Timbo pour exiger de Biro l'installation d'un poste français. Il quitta Dubréka avec une colonne de tirailleurs commandée par un capitaine français du nom de Aumer. Mais à la frontière, il se ravisa, y laissa par prudence les troupes et avança sur Timbo, accompagné du capitaine Aumer et d'un simple peloton.
Le 18 mars 1896, ce petit monde entra dans Timbo, drapeau tricolore et clairon en tête. Aussitôt reçu par le souverain, Beckmann réitéra sa demande. « Ma réponse est simple, lui dit l'almami. Promène-toi du nord au sud du Fuuta. Partout où tu verras un lopin de terre ayant appartenu à ton père, installe-toi et érige ton poste. Sinon, va voir ailleurs ! »
Echaudé par cette réponse, Beckmann se plaignit de la dureté de ton de l'almami. « Beckmann, répondit celui-ci, j'ai vu passer à Timbo de nombreux Français : Hecquart, Lambert, Bayol, Briquelot, Audéoud, Plat, Alby, etc. Aucun n'a fait preuve d'autorité, aucun n'a tiré un coup de feu. Nous avons signé avec vous un traité de commerce, nous nous en tenons à cela. Sache que les Fulɓe sont fiers, ils résisteront avec la dernière énergie pour conserver leur indépendance. Les Anglais, eux, ne changent jamais leurs traités. Les Fulɓe ne comprennent pas pourquoi les Français changent tout le temps. »
La guerre était à deux doigts d'éclater dans les rues de Timbo. Excédée, la population fourbit les armes, hurla des injures, jeta des pierres sur l'armée étrangère et brûla le drapeau français. Pour se protéger, Beckmann fit sonner le clairon et tirer des coups de feu en l'air. La situation était explosive, tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Bookar Biro n'avait rien à y gagner. Il savait que s'il avait vaincu ses ennemis et retrouvé son trône, la situation de son royaume n'était guère brillante. Les Fulɓe étaient plus que jamais divisés. La méfiance régnait entre le pouvoir central et les provinces, les haines grandissaient entre les familles princières. Inquiets et terrorisés, les gens du commun ne savaient plus à quel saint se vouer. Jamais une invasion étrangère n'avait été aussi propice. Après avoir mûrement réfléchi, Bookar Biro fit appeler Beckmann et lui signa volontiers son papier.
Satisfaite, la mission se retira le 10 avril 1896. Beckmann rentra à Dubréka et, d'un geste triomphateur, adressa aussitôt au gouverneur de Conakry le précieux document. Celui-ci fut bien étonné quand il le fit traduire. L'almami n'avait pas apposé sa signature en vérité. Il s'était contenté d'annoter ceci au bas de la page :
Alhamdu lillaahi, louange à Dieu, l'Unique ! De la part de l'almami Bookar Biro fils de l'almami Umar au gouverneur, salut le plus respectueux. Le but de la présente est de vous informer que nous avons reçu vos envoyés, le commandant Beckmann et le capitaine Aumer. Nous avons bien entendu ce qu'ils ont dit mais nous leur avons fait savoir que nous ne pourrions leur donner une réponse affirmative qu'après avoir vu le gouverneur et le gouverneur général et qu'après entente avec tous les notables du pays et qu'alors seulement tout ce qui serait décidé serait mis à exécution. Salut à celui qui suit le sentier droit ! 10
Le 18 mai, le gouverneur général, après avoir pris connaissance de la vraie teneur du document, écrivit ceci à Conakry :
Vous verrez que c'est plutôt une réserve formelle ou un ajournement qu'un assentiment. Je pense avec vous et je l'ai écrit au Ministre qu'en novembre prochain il en faudra finir avec tous ces atermoiements et la duplicité de Bookar Biro qui ne craint pas de faire publier partout au Soudan et en Casamance qu'il se refuse à signer tout traité et qu'il nous a forcés à nous retirer de Timbo 11.
C'est dans cette atmosphère surchauffée, toute de périls et de craintes, de violentes haines et de sombres machinations que mourut l'almami Amadu, précipitant le camp alfaya lui aussi dans le chaos et dans la tourmente et ajoutant à l'invraisemblable cacophonie qui secouait le pays. Son fils Alfa Umar et son neveu Umar Bademba sortirent les couteaux pour se chipoter sa succession à la tête des alfaya. Avec sa coutumière spontanéité, sa franchise âpre et son sens très rudimentaire de la diplomatie, Bookar Biro prit fait et cause pour Alfa Umar jusqu'à lui donner une résidence à Timbo et l'enrôler dans sa cour.
Umar Bademba en fut profondément ulcéré. Il prit cela comme une monstrueuse injustice et décida de se venger de Bookar Biro en rejoignant ses ennemis. Renforcés par ce soutien inattendu, les conjurés décidèrent d'en finir et se répartirent les rôles. Pendant que Sori Yillili arrivait à Siguiri, Umar Bademba se tourna vers Beckmann, le très goulu, le très retors, le très impatient administrateur de Dubréka. Beckmann qui n'en demandait pas tant multiplia les contacts avec les notables à travers son fidèle interprète, David Lawrence, excitant l'animosité des plus hostiles, noyant de promesses et de cadeaux les plus tièdes. Parallèlement, il harcela le gouverneur de Conakry pour le pousser à donner enfin l'ordre d'occuper le Fuuta. Les Français n'avaient plus à s'embarrasser de scrupules. Les chefs les plus prestigieux du pays les incitaient à le faire. Voici, par exemple, la lettre que, quelques jours plus tôt, le gouvernement Ballay avait reçue de Alfa Yaya :
Je remercie Dieu, Dieu le Grand, le seul Dieu, le Miséricordieux, et Mohamed, son prophète. Cette lettre est écrite par Alfa Yaya, fils d'Alfa Ibrahima, pour s'informer des nouvelles du gouverneur et tous les notables de Labe s'associent à moi à cet effet. C'est bien grâce à vous que je suis en ce moment tranquille et jouissant d'une bonne santé. Je suis, jour et nuit, avec tous mes sujets à votre disposition. Vous êtes le seul maître absolu de mon pays et nous sommes tous entre vos mains. L'almami Bookar Biro m'envoya dernièrement, par un messager, l'ordre de le rejoindre. Mais je l'ai répondu que dorénavant, il me laisse tranquille, que mon chef actuel se trouve à Conakry. J'apprends que Bookar Biro a l'intention d'assembler ses partisans dans le Fuuta pour essayer de m'enlever le pouvoir de Labe. Je me mets entièrement entre vos mains, ainsi que tout ce que je possède. Mais il faut que vous m'assistiez pour que j'aie l'autorité suffisante pour commander tous les pays qui m'appartiennent : Labe, Niokolo-Koba, Valendé, Voyokadi, Bagicé, Kabado, Kamoro, Vabica, Koula, Samboula, Kantora, Diamar, Firdu et autres, etc. Moi, Alfa Yaya, je vous donne tous ces pays dont je suis maître en ce moment, avec toute ma famille et mes sujets 12.
Bookar Biro était au courant de ce qui se tramait contre lui mais il ne bougea pas de Timbo. Il resta dans son palais comme un animal en cage, fustigeant la trahison des siens, maudissant l'arrogance des Français. Il fit exécuter tous les notables de Timbo qui leur étaient favorables. Il attacha au poteau les ambassadeurs de Beckmann. Au tout dernier moment, son frère Aliiyu apparut à l'improviste et le dissuada de les fusiller.
Beckmann reçut Umar Bademba et exulta de jouir enfin, et à si peu de frais, d'une aussi inestimable caution. Il ne lui manquait plus que l'ordre officiel du gouverneur Ballay pour marcher sur Timbo. Il dut patienter encore un peu car celui-ci se trouvait à Saint-Louis, où il assurait l'intérim du gouverneur général, parti en cure en Auvergne. À la mi-octobre, il reçut enfin l'autorisation tant attendue. Le 25, guidé par Umar Bademba, il quitta Songoya avec une colonne de tirailleurs commandée par le capitaine Aumer. Le 3 novembre, il entra dans Timbo. L'almami était absent. Au même moment, partait de Siguiri une autre colonne de tirailleurs commandée par le capitaine Piess et guidée par Sori Yillili. Avant d'entrer dans Timbo, celle-ci occupa Sokotoro et confisqua tous les biens de l'almami. Face aux troupes rassemblées devant le palais, Beckmann fit lever le drapeau tricolore et annoncer officiellement la prise de Tirnbo et son inscription sur la liste des possessions françaises d'Afrique. Il expédia aussitôt par Kankan ce télégramme de satisfaction au gouverneur général de Saint-Louis :
Administrateur Beckmann à Gouverneur Saint-Louis par Kankan. Très urgent. Sommes arrivés Timbo 3 novembre Peloton Aumer et Muller. Ville évacuée. Pas de résistance. Peloton Spiess arrivé premier Sokotoro a pris possession tous biens Bôcar Biro qui serait près de Fugumba et disposé d'après renseignements vagues à marcher sur Timbo. Spiess rejoint Timbo le 3 laissant poste Sokotoro pour garder seul le passage Bafin route Kouroussa Faranah. Alfa Ibrahima Fugumba adversaire Bôcar Biro entre le 6 à timbo avec nombreux guerriers. N'ai pu aviser Conakry 13.
Comme prévu, le 6 novembre, Alfa Ibrahima de Fugumba rentra à Timbo avec de nombreux guerriers et monta sur une estrade pour annoncer la nouvelle ère : « Prions Dieu et résignons-nous à sa nouvelle volonté, parents ! Dieu donne la couleur qu'il veut aux jours sortis de ses moules. Hier le Noir, aujourd'hui, le Blanc ! Au tout début les Coniaguis ! Après les Coniaguis, les Bagas, après les Bagas, les Nalous, après les Nalous, les Susu, après les Susu, les Mande, après les Mande, les Fulɓe, après les Fulɓe, les Français et après la fin du monde ! Alors viendra le jour du Jugement dernier quand sonnera le clairon du bon Dieu, celui qui est supérieur à tous les autres… » Le hasard voulut que, juste à ce moment-là, le clairon se fit entendre du côté de la plaine où campait la troupe française. Beckmann foudroya l'assistance de son regard d'oiseau de proie et ricana : « D'ici là, c'est notre clairon à nous qui gouverne. Qu'on se le tienne pour dit ! »
Le télégramme de Beckmann disait vrai : l'almami était absent de Timbo. Seulement, il n'était pas à Fugumba mais quelque part dans la province de Labe. Plus que toutes les autres, la trahison de son ami Alfa Yaya l'avait profondément ulcéré. En dépit des nombreux problèmes qui l'assaillaient, cette forfaiture prenait le pas sur tout le reste. Cet homme lui devait tout. C'est lui qui l'avait sorti de son trou de Kaade, réhabilité de ses nombreux crimes de jeunesse et imposé à la tête de la plus puissante province du pays au détriment de ses autres frères et malgré la farouche hostilité de la plupart des notables. Il devait éliminer le traître ! Il imagina donc un subterfuge. Il fit annoncer dans tout le Fuuta son intention de se rendre en pèlerinage sur la tombe de son père à Dombiyaaji, dans le Bajar, ce qui devait obligatoirement le faire passer par Labe. Par l'intermédiaire du roi de cette province, il fixa un rendez-vous à Alfa Yaya à Timbi-Tunni pour qu'il l'accompagne. Doutant des bonnes intentions de l'almami, Alfa Yaya s'avança jusqu'à Saniyon à la frontière du Labe et du Timbi-Tunni avec une puissante armée prête à le défendre s'il était attaqué. Le 8 novembre, sur la route de Timbi-Tunni, Bookar Biro fit une halte à Bambéto où la nuit l'avait surpris et en profita pour peaufiner les détails de l'exécution de son plan. Le 9 au matin, un messager de sa mère vint lui annoncer l'occupation de Timbo. Il décida aussitôt de rebrousser chemin et de marcher sur sa capitale pour déloger les envahisseurs.
— Père, lui dit Moodi Sori, réfléchis à deux fois avant d'affronter les Blancs, leurs armes sortent tout droit de l'enfer et leur traîtrise dépasse l'entendement. Les rois les plus illustres se sont brisés contre ces démons. Regarde ce qu'est devenu le grand Elhadj Umar, imagine la détresse de son fils Amadu aujourd'hui obligé de s'enfuir chez nos parents du Sokoto ! Ton ami Samori ne manque ni de bravoure ni de génie, n'empêche, à l'heure où je parle, il est confiné à la lisière de la jungle sans armes et sans provisions, condamné à pester de rage comme un buffle tombé dans les rets. Les Blancs sont nombreux, père, et nous, nous sommes seuls. Le Fuuta nous a abandonnés !
— Si tu as peur, dis-le-moi, tonna le grand lion, je m'adresserai aux bâtards et aux esclaves !
— Dans mes veines, coule ton sang, c'est un sang qui ne connaît pas la peur. Voici, il y a peu, ce que je disais à Beckmann : « Le jour où les Français rentreront dans le Fuuta, je serai la victime du devoir, ce jour-là. » Aujourd'hui, je n'ai aucune raison de changer d'avis. Je mettrai mon pied là où tu auras mis le tien. Je me battrai à tes côtés comme, jeune, tu l'as fait aux côtés de mon grand-père, l'almami Umar. Si je ne peux pas vaincre, je me battrai pour mourir. Je suis prince du Fuuta. Jamais un prince du Fuuta ne fera la corvée des Blancs !
— C'est ce que je voulais entendre…
Il se tut quelques instants puis se tourna brusquement vers ses autres compagnons.
— Et vous ?
— Notre devoir est d'être aux côtés de l'almami sous la fraîcheur comme sous le crépitement des balles, répondit Cerno Abdul Wahaabi, le président du conseil des Anciens.
— Vous avez vu mon cou ? C'est ce qu'ils veulent. Soit ! Je le leur offre. Mais je vois d'ici la triste lumière du lendemain de ma mort. Un océan de malheurs submergera le Fuuta, ce jour-là. La femme pullo sera dénudée et battue. L'homme pullo baissera le front pour supporter le fardeau de l'homme blanc… Ah, monne, cet insupportable goût d'aloès qui châtie mon palais, cette cruelle amertume d'avoir été trahi par les miens ! Ils en paieront les conséquences pour les siècles à venir. Le turban que je porte, ce n'est pas à eux que je le dois. Je suis almami par la volonté de Dieu. C'est moi l'almami du Fuuta. L'almami ne se révoque pas. L'almami règne ou meurt.
— Maintenant allons à Timbo, ô mon père ! Préparons-nous au grand sacrifice, mourons pour la terre de nos pères ! Pour ma part, dès cet instant, je remets à mes épouses leurs camisoles de deuil.
Avant de partir en guerre, l'almami se devait de convoquer les notables du pays. Bookar Biro savait que, cette fois-ci, personne ne viendrait. Il sacrifia au rite malgré tout comme si les gens étaient restés les mêmes, comme si la vie sentait pareil qu'avant… Alfa Yaya, qui se pavanait à quelques encablures de là, ne daigna pas recevoir le messager. Avec une soixantaine de partisans, l'almami Bookar Biro prit le départ pour Timbo. De son côté, Beckmann, qui le croyait à Fugumba, avait mis en branle ses troupes vers lui. La rencontre eut lieu à Porédaka, au petit matin du 14 novembre 1896.
L'armée française était escortée par Sori Yillili qui, à la vue des rangs clairsemés de Bookar Biro, indiqua à distance les têtes à abattre. La première décharge s'abattit sur le prince Moodi Sori qui tomba inanimé. Armés de fusils artisanaux et peu nombreux, les survivants continuèrent cependant à affronter les tirs des canons et des mousquetons. Cinquante d'entre eux tombèrent sans penser un seul instant à s'enfuir. Sori Yillili qui savait que les balles ne pouvaient pénétrer le corps de l'almami suggéra d'abattre sa monture. L'animal se cabra et retomba sur la jambe de l'almaini. Celui-ci réussit à se dégager du champ de bataille et à s'engouffrer dans la forêt-galerie d'une rivière voisine, malgré sa fracture. Il s'y cacha dans un fourré. On le chercha jusqu'à ce que Sori Yillili intervienne auprès de Beckmann : « Inutile de perdre notre temps. La forêt est trop épaisse et l'endroit est truffé de gouffres et de grottes. Son intention est de rejoindre Nafaya, dans le Tinkisso, où il dispose de nombreux guerriers en réserve et d'une quantité impressionnante de fusils et de munitions. Ce qu'il faut, c'est couper toutes les routes menant vers Nafaya. S'il y arrive avant nous, je crains que nous ayons à le payer. »
Profitant de la nuit, Bookar Biro claudiqua à travers la brousse, se nourrissant de racines et de baies sauvages. Épuisé par sa blessure qui commençait à enfler et à puruler, il s'effondra près du village de Bôtôré et fut recueilli par un forgeron du nom de Sâdou Bilima Kanté qui le soigna et le cacha dans son grenier. Le lendemain, Moodi Amadu, le frère de Umar Bademba, débarqua dans le village avec un groupe de soldats : « Je sais que le fugitif Bookar Biro est ici parmi vous. De deux choses, l'une : ou vous me le rendez ou je vous enferme chacun dans sa case et je mets le feu dessus. » Terrorisés, les habitants finirent par avouer et indiquer la case du forgeron. On trouva Bookar Biro en train de manger du manioc que venait de lui préparer son hôte. Il sortit aussitôt son fusil et tira mais il fut vite maîtrisé et abattu. Moodi Amadu coupa sa tête et la transporta à Timbo. Ligotée comme un fagot de bois, Neene Jaariwu, la mère de l'almami, fut contrainte de la porter sur la sienne pour traverser tout Timbo et de la présenter à Beckmann. Pour bien prouver que Bookar était fini et bien fini, on l'obligea ensuite à faire de même à Conakry, devant le gouverneur Ballay.
Les partisans et proches parents de l'almami furent exécutés. Ses trois plus jeunes fils — l'aîné n'avait pas encore quinze ans — réussirent à s'échapper au Soudan français où ils se fondirent parmi les Bambaras.
C'est ainsi que finit le royaume du Fuuta-Jalon.
Ta bâtarde de race ploya, trembla un bon coup et se ressaisit. Elle jeta un œil humide sur sa terre soumise et humble et sur les guêtres de l'occupant, puis, invoquant la fatalité, décida de se faire une raison. Ce n'était pas la première fois qu'elle s 'inclinait, après tout, sous les coups de boutoir de l'inimitié et de la guigne ! Si Allah lui avait envoyé ça, c'est que Allah avait ses raisons. Elle songea à ses traces obscures et à ses poussiéreuses mythologies, à ses dieux perdus et à ses improbables origines, à ses déplorables conquêtes et à ses dynasties aux destinées plus shakespeariennes les unes que les autres. Tout cela lui paraissait soudain si loin, si futile, si étranger, si incompréhensible ! Elle se frotta les yeux et supputa longuement sur les aléas de l'Histoire et le cirque de l'existence.
Elle se dit qu'il n'était peut-être pas plus mal de changer de saisons et de maîtres. Les choses devaient bien un jour s'arrêter a force de reproduire tout le temps les mêmes soleils et les mêmes pluies, de réveiller dans les bouches ce goût suranné de fatigue et de mort que l'on s'efforçait depuis longtemps de repousser et d'oublier. Maintenant que l'incendie avait cessé, l'on devait apprendre à survivre sous le poids des eaux qui avaient servi à l'éteindre. À chaque époque, sa façon. L'on avait vu passer la monnaie en cauris et les prières dans les grottes, la mode du port des tresses et les habits en peaux de bêtes, l'on avait vu finir les razzias et les grands exodes, les feux de volcan et les temps des grandes secousses, les chutes spectaculaires des comètes et les apparitions de Koumène. Et maintenant, c'était la fin des Fulɓe.
Elle se dit que puisque son monde à elle s'était définitivement évanoui, elle devait se préparer à l'ébauche du nouveau, celui de la Guinée française. Conakry devait compter alors deux mille âmes tout au Plus, outre les prélats et le gouverneur, les soldats, les métis et les tirailleurs, essentiellement des indigènes plus amusés que terrorisés, plus ahuris que soumis devant le nouvel ordre des choses. La seule épicerie du coin servait aussi de banque, de poste et de guichet pour les billets de bateau. Une route boueuse reliait le port au palais du gouverneur et quelques sentiers larges de deux coudées serpentaient hasardeusement entre les amas de détritus ou s abattaient les vautours, les rares pavillons coloniaux et les cases en forme de meules où s'entassaient les Nègres. Il y avait une seule boulangerie et pas encore de prison. Au début, on s'était contenté d'enchaîner les voleurs et les insoumis aux arbres tout au long des rues, puis on les avait distribués ici et là : un groupe pour le port, un autre pour la léproserie ou pour les dépendances du palais. Puis on avait pensé aux casemates de la garnison où les tirailleurs souffraient inutilement de mycoses et les munitions d'humidité. C'était un sous-sol d'étroites pièces à la géométrie quelconque, rangées le long d'un couloir où le lichen noircissait les murs, où les égouts et les eaux de mer ruisselaient de partout. « Par le figuier et l'olivier ! Et par le mont Sinaï ! Et par cette cité sûre ! Nous avons certes créé l'Homme et dans la forme la plus parfaite. » La nuit, l'on entendait les pas des gardes, le cliquetis de leurs armes, les hurlements des hyènes et des chiens, les bruits épouvantables des prisonniers devenus fous. « Ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. » Des numéros avaient été hâtivement inscrits à la craie bleue et sans aucun ordre sur les portes de tôle gondolée. « Ceux-là auront une récompense jamais interrompue. » Tout au fond du couloir, là où les murs avaient été directement taillés dans la roche, se trouvait le numéro 12. « Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge ? Allah n'est-il pas le plus sage des juges ? » C'est de là, du numéro 12, que provenaient les prières. Ils étaient quatre dans cette pièce mal éclairée par la lumière blafarde d'un étroit soupirail et accompagnaient les versets que déclamait celui qui avait l'air le plus jeune, en remuant la tête. Puis celui qui avait une écharpe au cou s'arrêta de bouger et dit :
— Nous sortirons d'ici, nous retournerons chez nous, au Fuuta-Jalon ! Mettez vos mains sur le coeur, jurez-le tous !
Ils jurèrent et l'homme à l'écharpe reprit :
— « Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est Lui, le Puissant, le Sage. »
Les gardes étaient brutaux et cyniques mais ils étaient leurs seuls liens avec l'extérieur et le tas de grains de riz que Boori entretenait dans un coin de la pièce, la seule chose qui les reliait au temps. Avec les gardes et avec ce calendrier, ils pouvaient sans peine reconstituer les événements en suivant le cours du temps.
Un jour, Boori scruta longuement son tas de grains de riz et dit.
— Il y a deux cent quatre-vingt-dix-sept jours que nous sommes ici et exactement deux cents jours que Neene Jaariwu, la mère de l'almami, a été libérée. La pauvre, elle n'a pas eu le courage de revoir Timbo. Elle est allée directement enfouir son chagrin à Sira-Kouma, son village natal.
Une autre fois, de retour de l'infirmerie, il s'affala sur sa paillasse et se tourna vers le mur pour ne pas montrer ses larmes.
— La pauvre, elle est morte la semaine dernière. Porter la tête de son fils de Timbo à Conakry, aucune mère ne pouvait longtemps survivre à cela !
Le trois cent soixante-dix-huitième jour, il annonça, bouillant de colère :
— Cerno Ibrahima Dalen, le marabout de l'almami, a réussi à se faire libérer… Vous ne me demandez pas ce qu'il est devenu ? Interprète de pular et d'arabe auprès du gouverneur Ballay ! Ah, si Bookar Biro avait su ça !
Au quatre cent soixantième jour, on ouvrit la porte en pleine nuit et on poussa dans la salle un groupe de voleurs de boeufs. Le gardien alluma un mégot de cigarette, lança quelques mauvaises blagues et crut devoir s'excuser tout en éclairant le visage des brigands avec sa torche de paille :
— Vous allez devoir vous serrer, il n'y a plus de place ailleurs.
— Dites-le aux grenouilles et aux rats, ce sont eux qui occupent le plus de place ici, ricana celui qui s'appelait Alfa.
— Nous sommes les compagnons de l'almami. On n'a pas à nous mêler aux voleurs de bœufs ! protesta vainement Dooya Malal.
Le lendemain, l'on profita de la lumière de l'aube pour scruter les nouveaux arrivants. Ils étaient au nombre de trois. L'un avait perdu son pied droit et le plus jeune portait une balafre à la joue. Ils avaient des tignasses de troubadours, sentaient la chique et les lianes de brousse et portaient tous des traces de coups.
— Ce sont les gardes, ça ? demanda Alfa qui pensait naïvement que l'on pouvait être taquin en n'importe quel endroit du monde.
— Que ce soient les gardes ou les fantômes venus de la mer, cela ne regarde que nous ! grogna le plus gros, celui qui portait des boucles d'oreilles et un bracelet au poignet.
— Pardonnez, parents ! Ce n'est pas pour vous vexer, juste pour vous parler un peu. Nous sommes appelés à vivre ensemble pour un bon moment, nous devons forcément nous parler.
Ils restèrent de marbre tous les trois, à raidir le cou, à se ronger les ongles, à regarder d'un commun mouvement les toiles d'araignée du soupirail. Cela ne découragea pas Alfa qui prit une voix plus douce, pensant que cela les rendrait plus affables :
— Moi, je m'appelle Alfa. Les autres s'appellent Boori, Jibi et Dooya Malal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes les derniers compagnons de l'almami. Maintenant, vous savez qui nous sommes. Vous pouvez nous dire vos noms si vous le voulez, sinon…
Il voulait dire « sinon ça ne fait rien » mais sa phrase resta en suspens un bon nombre de minutes puis le plus jeune, celui qui avait une balafre à la joue, murmura :
— Moi aussi, je m'appelle Dooya Malal. Descendre jusqu'au fond de l'enfer et y trouver un homonyme, c'est vraiment ce qu'on appelle le hasard !
— Dis-moi, homonyme, serais-tu de Timbo, toi aussi ?
— Non, je n'ai rien à voir avec les almami.
— De Labe ?… De Timbi Madina ?… De Koyin ?… Alors je ne peux pas deviner, je n'ai jamais été plus loin que ça.
— Ça nous aiderait tous si tu arrivais à lui faire dire d'où il vient, fit le gros.
— Parce que vous ne le connaissez pas non plus ? s'étonna Dooya Malal.
— Dans notre métier, on n'a pas besoin de ça, savoir d'où l'on vient. Chez nous, moins vous parlez et plus on vous prend au sérieux.
— Comment faites-vous pour vous nommer ?
— Chacun vient avec son sobriquet en même temps que ses lassos et ses armes.
— Vous vous êtes bien rencontrés quelque part ? s'amusa Alfa.
— Ah ça, oui ! Mais pas au Fuuta-Jalon !
— Nous ne connaissons pas le Fuuta-Jalon, nous n'y avons jamais mis les pieds ! s'énerva le jeune homme à la balafre.
— Si vous n'êtes pas du Fuuta-Jalon, d'où pouvez-vous être ? se hasarda Jibi.
— Regardez du côté de la Gambie! Nous ne sommes pas du même village, mais ce qui est sûr, c'est que nous venons tous de la vallée de la Gambie.
— C'est en Gambie qu'ils auraient été vous chercher ?
— Non, rigola le gros, ce serait plutôt nous qui serions venus à eux… Nous flânions du côté du Bôwé, vous comprenez, et puis nous nous sommes laissés tenter par les beaux cheptels de Boké. C'est là que nous nous sommes fait prendre, il y a trois mois de cela.
— On nous a jugés le mois dernier, expliqua le jeune homme à la balafre.
— Et vous en avez pris pour combien ?
— Pour toujours, pardi ! s'esclaffa l'unijambiste.
— C'est dans l'île de Fotoba que nous finirons nos jours, reprit le balafré. Ici, nous ne faisons que passer. Le temps qu'ils aient fini la prison souterraine qu'ils sont en train de creuser là-bas dans la roche ! Vous, vous serez bientôt libres, les gardes nous l'ont dit. Normal : vous, on vous a pris en train de vous battre contre les Blancs ; nous, en train de voler des boeufs.
C'est cette semaine-là que commença la pluie. Il se mit à tomber une bruine régulière et douce qui ajoutait au désarroi et à la lassitude et poussait à méditer ou à somnoler. Mais cela dura des semaines, des mois, des années peut-être. Ce qui fait que très vite, les fossés se remplirent et les puits débordèrent; des terrasses et des murs s'effondrèrent, des gamins et des chiens se noyèrent, emportés par les eaux de ruissellement. Apitoyés, les gardiens distribuèrent des hamacs et des sacs de sable. Cela ne changea pas grand-chose. Cela ne pouvait changer grand-chose. Au numéro 12, on s'était, il y a bien longtemps, habitué à la chaleur et à l'humidité, à l'ankylose et à la crasse, au bannissement et aux rats.
Au trois cent quatre-vingt-quinzième jour, Boori apporta d'autres nouvelles fraîches.
— Moodi Saiidu, le secrétaire de l'almami, a été libéré il y a plus de six mois. Mais les Blancs lui ont interdit de retourner au Fuuta-Jalon.
La vie s'écoula ainsi dorénavant au rythme de la pluie, par la grâce de la pluie, dans la mélodie même de la pluie; inscrite dans la pluie, détachée du temps. Et c'était comme si les paroles insensées des hommes, le frôlement des souris contre les parois des murs, les bruits des brodequins et des portes, provenaient des trombes, s'égouttaient des toitures et des palmiers, ruisselaient des tuyauteries et des murs.
— Moodi Saiidu et ses gens se sont installés à l'entrée de la ville, ils ont bâti un nouveau quartier. Ce quartier s'appelle Dixinn.
Ça, c'était au quatre cent vingtième jour ou au cinq centième. Car les dates aussi provenaient de la pluie comme les soupirs, les bâillements, les ronflements bestiaux, les quintes de toux, les mauvaises idées et les élans de cœur. Même les résidus de la mémoire et le refoulement des envies !
Au cinq cent vingtième jour, Boori recompta ses grains de riz et dit :
— Le Blanc a nommé Sori Yillili l'almami des soriya et Umar Bademba, celui des alfaya.
Les bateaux arrivaient malgré la pluie. On entendait leurs moteurs gronder et le son lugubre de leurs sirènes faire vibrer les murs.
— Les trois fils cadets de l'almami se sont enfuis vers Kayes pour échapper au carnage. Oh, malheur, ils vont devenir des Bambaras !
Maintenant l'odeur âcre du charbon provenait de là-haut, non plus de l'autre côté du couloir, à croire qu'ils avaient monté les cuisines dans les bureaux pour pouvoir faire du feu.
— Si l'almami avait réussi à atteindre Nafaya, les choses ne se seraient pas passées ainsi. C'est à Nafaya que l'attendaient ses guerriers et ses armes… Maintenant la question est de savoir si l'année prochaine, les Blancs seront encore là.
Puis un beau jour, le jeune homme à la balafre s'approcha de Dooya Malal.
— Tiens, prends ça, homonyme ! lui dit-il.
— Qu'est-ce que c'est ?
— Regarde toi-même et dis-moi ce que c'est !
— C'est un bijou !… Ou alors un gri-gri !
— Garde-le ! Là où je vais, je n'en aurai pas besoin. A Fotoba, on n'a besoin que de son corps pour pourrir debout sur ses deux jambes et mourir.
Dooya Malal projeta l'objet d'une main à l'autre, le scruta longuement et demanda :
— Tu ne veux pas me dire ce que c'est ?
— A vrai dire, je ne le sais pas moi-même.
A cause de l'eau, on arrêta les génuflexions et on se contenta de prier dans la tête. C'était écrit : après les Coniaguis, les Bagas puis, les Nalous, puis les Susu, puis les Mande, puis les Fulɓe puis les Français. Après les Français, la fin du monde !…
— Dis-moi, homonyme, tu l'as ramassé dans une grange ou, bien c'est là-bas, dans le Bôwé, que tu l'as arraché à une de tes victimes ?
— C'est mon père qui me l'a donné. Il l'a lui-même reçu de son, père. Cet objet appartenait à un de mes ancêtres du Fuuta-Tooro. Si j'en crois les griots, il serait le premier Noir à avoir planté de la tomate et du mais dans les pays des trois fleuves. Mais à quoi pouvait bien servir cet objet ? Je n'en sais rien. Même si j'avoue que, jusqu'ici, il m'a plutôt porté chance. Enfin, jusqu'à il y a trois mois…
— Il t'a laissé là un drôle d'héritage, homonyme !
Il regarda de nouveau l'objet puis le porta à son cou.
— Il te va très bien, homonyme !
— Alors, pour moi, ce sera un bijou. Pas un talisman !
— Garde-le ou vends-le aux Blancs. En Gambie, les Anglais offrent mille cauris pour une poterie, trois mille pour un masque.
C'était l'hexagramme de coralline.
Jibi, Alfa et Boori décidèrent de gagner la Sierra Leone. Dooya Malal, lui, allez savoir pourquoi, choisit de rester ici dans l'air hydrique de Conakry, sur sa terre spongieuse cernée par la mer, noyée sous les eaux.
« Ah, si cette pluie pouvait cesser, que je puisse mourir en paix ! »
Il trouva un guide pour Dixinn, il le suivit en serrant dans sa main son hexagramme de coralline.
Il avança dans les eaux de ruissellement sans faire attention aux grenouilles et aux cadavres de chiens. Quelque part, il se sépara de Jibi, Alfa et Boori qui prirent le chemin du port où un bateau viendrait un jour les porter vers les mangroves de Sierra Leone.
« Ah, si cette pluie pouvait cesser, que je puisse mourir en paix ! »
Il quitta l'île de Tombo en pirogue et traversa un long no mans land de palmiers et d'épiniers enserré par la mer. Il déboucha sur une petite bourgade et quelqu'un lui dit que c'était Dixinn. Un îlot d'habitations au milieu des bambous. Les paillotes et les maisonnettes en tôle étaient si récentes qu'elles n'avaient pas encore reçu leur première couche de peinture. Un gamin vint à sa rencontre, se saisit de son sassa et de ses hardes. Moodi Saiidu l'attendait dans une pièce, assis sur une natte près d'une caisse vide de savons de Marseille où étaient posés son chapeau, ses lanières et sa couverture. Il lui offrit un bain et lui servit à manger. Le gamin se montra de nouveau et le conduisit dans une maisonnette à persiennes isolée sous les bambous. Il foula son perron à deux marches, passa sa porte à double battant et décida de ne plus en sortir. Il s'étala sur les nattes et écouta la musique des grillons, des grenouilles et des frelons.
Le lendemain, une femme soussou lui présenta une écuelle de riz avec de l'huile de palme, du soumbara et du gombo.
— Le prince Alfa Umar qui s'était réfugié chez Cerno Ndaama s'est rendu aux Blancs ! Mais ne vous en faites pas, vous retournerez tous au Fuuta ! Le chemin appartient à Dieu, le chemin n'appartient pas au Blanc ! Tu entends, le Pullo ?…
Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle,
dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-mêmev (à cause de sa richesse)
mais c'est vers ton seigneur qu'est le retour...
« Ah, si cette pluie pouvait cesser, que je puisse mourir en paix ! »
La pluie cessa un vendredi matin.
L'après-midi, la femme soussou lui apporta son repas.
— Hier, en balayant sous ton lit, j'ai ramassé quelque chose… Tu me le donnes ? Pourquoi tu ne réponds pas ?… Si tu ne dis rien, cela veut dire que tu me le donnes… Est-ce que tu m'entends, le Pullo ?…Le Pullo, il n'entend plus, fit-elle pour elle-même avant de se glisser au-dehors.
Il mangea de bon appétit en regardant à travers les persiennes la tache lumineuse du soir ainsi que la plaie purulente de grisaille et de pourpre que le soleil creusait dans les sphères de l'ouest. Il écouta les battements d'ailes des charognards sur la toiture de tôle, puis la musique des frelons et les longs coassements des grenouilles.
Sur la même peau de chèvre où il venait de prier, il s'étala de tout son long, la tête tournée vers La Mecque.
Il éternua trois fois et mourut.
Notes
1. Boubakar Barry, La Sénégambie du XVe au XIXe siècle.
2. Erratum. Il faut lire prince Seediyanke. [T.S. Bah]
3. Olivier de Sander-val, cité par T. M. Bah, Histoire du Fuuta-Djallon.
4. Ibid.
5. Onomatopée dont usait abondamment Samori Touré.
6. B. Barry, Ibid.
7. Ainsi s'appelait la mère de Bookar Biro.
8. Sérail.
9. Thierno Mamadu Bah, Ibid..
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Ibid.
13. Ibid.