Maître-assistant à la Faculté des Lettres de Dakar
Editions ABC. Paris, Dakar, Abidjan. 1975. 109 pages
Collection Grandes Figures Africaines
Direction historique: Ibrahima Baba Kaké. Agrégé de l'Université
Direction littéraire : François Poli
Les légendes ont la vie dure et les énigmes de l'Histoire-ont toujours été un terrain fertile à l'imagination des hommes : le mystère de l'origine des Foulbé (singulier : Poullo), aujourd'hui résolu, n'a pas échappé à la règle. On est allé jusqu'à dire qu'ils étaient métissés
Aussi bien, pour Mohammed Fodio, le fils qui vient de lui naître ce vingt-neuvième jour du mois de Safar de l'année 1168 de l'Hégire (15 décembre 1754) descend, comme tous les Foulbé, des amours légendaires de Uqba ben Nafi, conquérant arabe de l'Afrique du Nord, et de la princesse berbère Bajjomangu, une chrétienne convertie à l'Islam !
Historiquement, cette version romanesque de l'origine du peuple foulbé n'est pas plus sérieuse que les autres. Mais Mohammed Fodio, maître, scribe et chef religieux du clan torobé (hommes pieux), établi dans le village de Maratta, la préfère à toutes les vérités scientifiques: pour lui, les Foulbé descendent en ligne directe d'un proche compagnon du prophète. Et dans cette principauté du Gobir où sa communauté fait une longue halte, eux seuls, les Foulbé détiennent le savoir, la vraie foi, la lumière, n'en déplaise aux seigneurs ignares et corrompus qui gouvernent ces terres. L'enfant se nommera Othman, dan (fils de) Mohammed, dan Othman, dan Salih, dan Fodio : Othman dan Fodio.
On ignore beaucoup de choses du père d'Othman, le nombre de ses chevaux ou de ses esclaves, par exemple, mais cela n'a guère d'importance Les enfants foulbé appartiennent moins à une famille qu'au clan à la communauté. Et c'est la communauté torobé tout entière qui va célébrer l'événement de la naissance d'un nouveau mâle.
Quand les matrones quittent la concession de Mohammed Fodio, cinq cases de briques cuites recouvertes d'un toit conique en paille, entourées d'un petit jardin, l'heureux père se rend à la zaure, la case communale située à l'entrée du village où les hommes ont l'habitude de prendre ensemble leurs repas, de bavarder dans la fraîcheur du soir d'accueillir les visiteurs de passage. Dans la vie très sévèrement réglée de ces musulmans orthodoxes, les occasions de fête sont assez rares et tous les amis de Mohammed Fodio accourent pour le féliciter. Pendant que les femmes préparent des calebasses de mil savamment épicé, s'élèvent de la zaure des psaumes religieux et ces lentes mélopées du folklore nomade venues des fonds de l'Afrique et du temps.
— Mais que dit son horoscope ? s'inquiète Bindawo, le jeune frère de Mohammed Fodio.
— Que c'est un beau jour pour naître, Bindawo. Un beau jour pour naître, grâce à Dieu, répond le chef religieux.
Le sort des Foulbé, sur cette terre d'Afrique, est de mener leurs troupeaux au gré des saisons, des pâturages, des points d'eau et de l'accueil des populations. L'accueil est parfois amical, parfois hostile. Les Foulbé vivent uniquement d'élevage, troquant le beurre, le laitage et — plus rarement — la viande de leurs troupeaux contre le mil et le coton des paysans sédentaires. Souvent écrasés de taxes par les chefs locaux, ils décident, quand l'injustice est trop flagrante, d'aller tenter leur chance sous d'autres cieux. Ceux d'entre eux qui ont quelque rudiment de savoir parviennent à se glisser dans l'entourage d'un seigneur païen ou musulman.
Ils y occupent les fonctions d'enseignants de maîtres du Coran, et acquièrent de la sorte une influence considérable parmi leurs élèves (qu'ils alphabétisent en arabe) et parmi les musulmans de la communauté désireux de mieux régler leur vie sur les principes islamiques. Quelquefois, leurs connaissances, leur intelligence, en font des conseillers écoutés, au risque de devenir des victimes désignées quand meurt leur protecteur.
Le clan de Mohammed Fodio ne fait pas exception. C'est un clan toucouleur appelé torobé ou toronkawa, originaire du Fouta-Toro. D'ouest en est, il a nomadisé en lisière du Sahara au cours des siècles, avec des fortunes diverses. Ainsi, Othman dan Fodio n'a pas deux ans quand la communauté de son père abandonne Maratta pour se fixer, provisoirement, à Degel, une bourgade de la principauté Gobir située à proximité de l'actuelle Sokoto (Nigeria). C'est là qu'il passera son enfance. Une enfance pieuse, comme celle de tous ses petits camarades, l'instruction religieuse commençant pour ainsi dire au berceau.
Ainsi, quand le petit Othman réclame une histoire à sa mère Hawa — et il en est friand —, elle lui raconte comment Ibrahim (Abraham) a été sauvé par l'ange Gabriel du bûcher où l'avait fait précipiter le tyran Nimrod.
— Et les flammes, dit-elle, se transformèrent en un merveilleux jardin vert.
— Que fit Nimrod, ma mère? demande l'enfant émerveillé.
— Aveuglé par son fol orgueil, poursuit Hawa, il attela des aigles à son char de guerre pour se lancer, à la conquête du paradis. Naturellement, Dieu le punit de son audace en logeant un moustique dans son crâne et ce moustique y bourdonne depuis plus de mille ans !
Hawa racontait aussi l'histoire du Prince aux deux cornes, version islamique de l'épopée d'Alexandre le Grand qui, à la recherche de la vérité, parvint sur les territoires de Gog et Magog, aux extrêmes limites de la terre, et y bâtit un colossal mur de blocs de fer. Et l'histoire de la ville de Brass, habitée par les « djinns » , les génies, où tout se passe à l'envers puisque les animaux y commandent aux humains et que les femmes, comme on dit aujourd'hui, y portent la culotte.
Othman dan Fodio ne se lassait pas d'entendre ces légendes à la gloire de Dieu, mais celles qu'il préférait par-dessus tout concernaient les combats du prophète Mohammed contre Iblis, le diable, les infidèles et les hypocrites. A peine s'il ne contestait pas la part prise dans ces combats par les archanges Mikaïl, Azra'il, Asrafil : il devait suffire au Prophète d'apparaître sur les champs de bataille pour pétrifier de terreur et couvrir de honte ses ennemis.
De telles histoires embrasaient l'imagination de l'enfant. Elles devaient le préparer à l'instruction que son Père dispensait à l'école coranique. De fait, dès qu'il atteint l'âge de raison, Othman rejoint le groupe d'élèves qui s'accroupissent autour du maître Mohammed sous le maigre feuillage des acacias. Là, il va apprendre a lire et à écrire l'arabe littéraire, à réciter le Coran par coeur, s'appliquant à respecter les intonations et la ponctuation du texte sacré.
C'est l'essentiel de ce que les enfants apprennent dans les écoles coraniques — encore de nos jours — mais l'élève Othman dan Fodio semble avoir été remarquablement doué.
Précisons enfin que l'ambiance, à Degel, est studieuse. La journée de la communauté est rythmée par les cinq prières qu'annonce le muezzin entre le lever et le coucher du soleil. Entre leurs cours et leurs repas et les corvées réservées aux enfants de leur âge, les élèves ont, certes, le temps de s'amuser. Ils en ont le droit, à la condition expresse de ne pas troubler la méditation des vieillards accroupis à l'ombre des murs de brique ou les travaux intellectuels d'un maître comme Mohammed Fodio.
En fait, les enfants s'amusent en silence avec les jouets qu'ils ont appris à fabriquer en tressant des brins d'herbe et d'osier. Les plus turbulents n'ont même pas le loisir d'organiser courses ou jeux de mains sans être immédiatement rappelés à l'ordre. A peine si la quiétude du village musulman est troublée par le hennissement d'un cheval énervé, le chant discret d'une gracieuse lavandière ou les dits et répons qu'échangent deux lettrés par-dessus leurs grands livres.
En 1770, aux alentours de sa quinzième année, Othman dan Fodio est déjà imprégné de culture et de piété musulmanes. C'est, au physique, un garçon dans la moyenne. Mais l'on remarque déjà son sérieux, sa gentillesse et ce goût de la méditation qui fera dire à son père qu'Othman possède des dons surnaturels, dont celui de chasser les djinns. Dès lors, sa route est tracée. Sa rencontre avec Jibril ben Omar sera déterminante.
La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la communauté : le cheikh Jibril ben Omar est à une journée de marche de Degel. Sans aucun doute, il sera là avant le coucher du soleil.
La visite du cheikh est toujours un événement. Ce Targui est un homme de haute taille, de belle prestance et de grande culture. Il nomadise avec ses dromadaires jusqu'au coeur du Tchad, dresse ses tentes dans le Nord-Cameroun, fait de longues retraites à Agadès, redescend par le Nord-Nigeria, au gré des saisons et des pâturages.
On ne le voit pas souvent, et pour cause, chez les Foulbé du clan torobé, mais il est toujours accueilli avec plaisir et respect. Avec plaisir parce que les Touareg et les Foulbé sont généralement liés par la vieille complicité qui unit les nomades confrontés aux populations sédentaires. Au point que Jibril compte parmi ses épouses une soeur de Mohammed Fodio.
Avec respect parce que cet homme des sables et des savanes est l'un des Africains les plus instruits de son temps : deux de ses dromadaires sont lourdement chargés de livres et de manuscrits qui constituent, pour l'époque, une fabuleuse bibliothèque. C'est dire avec quelle joie le fin lettré qu'est Mohammed Fodio ordonne que soient égorgées deux chèvres pour le repas du soir et que l'on selle son cheval blanc: il ne laissera à personne, le soin d'aller au-devant de son ami.
La journée semblera particulièrement longue à Othman dan Fodio. Il se souvient encore de la dernière visite du cheikh Jibril, une dizaine d'années plus tôt ; de l'espèce d'angoisse — comme une boule au fond de la gorge — qui l'avait étreint quand son père lui avait demandé de réciter un verset du Coran devant son hôte illustre. A l'époque, il commençait à peine à déchiffrer les caractères arabes et la crainte de se tromper le paralysait. Comme le temps a passé ! Aujourd'hui, il est conscient de ne plus avoir grand-chose à apprendre de son père, au moins dans le domaine des études. Et l'honneur de rencontrer Cheikh Jibril Ben Omar, il ne l'ignore pas, va se traduire par une espèce d'examen de passage qui engagera son avenir.
De fait, à trois heures de marche du village, dans la poussière soulevée par le troupeau du Targui, le père d'Othman ne tarit pas d'éloges à propos de son fils
— Tu sais, Jibril, que je n'ai plus d'autre ambition que de gagner mon paradis par la prière et par la charité. Mais je crois mon fils Othman capable de grandes choses. Avant de quitter cette terre de misère, je voudrais lui permettre d'apprendre tout ce que j'ignore.
— Comme tu en parles. Mohammed ! Ton fils est encore un enfant. Avant qu'il soit capable de te tenir tête en matière d'érudition la laine de ses cheveux aura commencé à blanchir.
— Je te l'accorde, c'est toujours un enfant, répond Mohammed Fodio avec fougue. Mais il est déjà pubère, et sa soif de connaissance est telle que je n'ai plus grand-chose à lui apprendre. Ce qu'il lui faut, maintenant, ce sont les meilleurs maîtres. Des hommes tels que toi, Jibril. Des hommes tels que toi.
— Tu me fais grand honneur, Mohammed. Et que Dieu me préserve du péché d'orgueil ! Quand nous aurons vu Othman, nous aviserons.
Le festin préparé à l'intention de Cheikh Jibril ben Omar est servi dans la zaure, la grande case communale. Othman dan Fodio a le privilège d'y assister. Certes, son âge lui interdit de se tenir à proximité immédiate du sage, mais pour notre héros cela n'a guère d'importance puisqu'il le voit et l'entend, et l'écoute au point de ne pas toucher aux plats qui lui parviennent. Othman est franchement subjugué par le Targui. Jamais, de toute sa vie, il n'a eu l'occasion de rencontrer un homme d'une telle autorité. Son père — et Dieu sait s'il le respecte — lui fait l'effet d'un écolier devant son maître, Jibril ben Omar connaît tout, a réponse à tout, tranche de tout. De temps à autre, pour donner plus de poids à son argumentation, il demande à l'un de ses serviteurs d'aller chercher sous sa tente l'une des besaces de cuir souple qui renferme les précieux livres et manuscrits acquis auprès de marchands ou de pèlerins qui ont fait le voyage de la Mecque, du Caire, de Damas, d'Alger, de Fès ou de Tombouctou.
Alors, il déroule avec soin le parchemin, choisit sa page et, sous la flamme menue de la lampe à huile, lit d'une voix singulièrement timbrée quelque poème sacré jamais encore entendu à Degel. Othman a l'impression d'entendre la propre voix du Prophète. Il est grisé par le verbe. Il ne cherche même pas à dissimuler les frissons et les tremblements de son corps. Il est sous le charme de l'homme du désert. Son émotion est telle que lorsque le Targui lui adresse la parole, lui pose une question, Othman s'entend répondre machinalement, comme si un autre avait parlé à sa place.
Heureusement pour lui, fi s'entend répondre juste. Car les questions de Jibril ben Omar à Othman n'étaient pas fortuites : sans en avoir l'air, le Targui jugeait des connaissances, du bon sens, de l'intelligence du fils de son ami Mohammed. Et quand les dernières getas de lait de chamelle ont été vidées, quand les flammes des lampes à huile commencent à vaciller, quand enfin le Targui regagne son campement dressé à la lisière du village, il rassure son hôte qui le raccompagne :
—-Tu avais raison, Mohammed. Ton fils aîné est de l'espèce dont on fait des maîtres. Il est temps qu'il voie du pays. A Kano, le Shehu Abdur Rahman dan Hamada lui apprendra la grammaire et la syntaxe ; à Sokoto, mon ami Othman Bindawo Bakebbi lui apprendra la poésie ; à Katsina, Hashimu Bazanfare, Amadou dan Mohammed Aminou et Mohammed dan Raji feront de lui un expert en exégèse et en traditions. Alors, ton fils Othman pourra venir me rejoindre à Agadès où nous ferons de lui le plus brillant des shehu du pays haoussa.
Ainsi, Othman dan Fodio, jusqu'à l'âge de vingt ans, va suivre de ville en ville la rigoureuse université islamique. Sous la férule de son propre père, il avait été initié dans le Coran à l'arabe littéraire. Grâce au cheikh Jibril ben Omar et aux maîtres que le Targui lui a choisis, il va devenir un spécialiste en grammaire et commentaires, en astronomie, en mathématiques, en médecine.
Héritier de l'enseignement scientifique et philosophique des Grecs de l'Antiquité, l'islam, longtemps, sera le seul dépositaire de la culture du monde méditerranéen. Certes, à la fin du XVIIIe siècle, les théories scientifiques de l'Antiquité sont largement dépassées: le monde arabe ignore tout des travaux de Copernic, de Galilée, de Newton, de Buffon. Il lui manque d'avoir vécu la révolution technique et intellectuelle de la Renaissance européenne.
Il est vrai que la question, en pays haoussa, n'est pas encore dl actualité. Alors même que l'Europe occupe déjà, sur la façade atlantique de l'Afrique, tous les points stratégiques entre Saint-Louis-du-Sénégal et le cap de Bonne-Espérance, on y vit encore comme à l'époque du bas Moyen Age.
Et la progression de l'Islam, malgré ses lacunes, constitue un progrès indéniable en Afrique noire. Dans les écoles qu'il fréquente, destinées à former les maîtres du Coran, Othman dan Fodio apprend tout du Prophète, sa pensée, ses révélations, son action, ses miracles. Bientôt, il saura parfaitement exprimer son savoir en vers et en prose et sera alors apte à étudier les fiqh, c'est-à-dire les lois que tout bon musulman doit observer non seulement dans le cadre de sa vie privée mais dans celui de la cité.
Rappelons que le code islamique, comme celui de Moïse, règle l'ensemble de la vie sociale. Il légitime le pouvoir. Il sert de code civil, de constitution politique, de règle personnelle. Othman apprend quel châtiment réserver au voleur et au criminel, comment régler un épineux problème d'héritage, comment gouverner ; le Coran permet au fidèle de se comporter en bon musulman quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit où il se trouve.
La tradition de l'Université islamique s'est perpétuée jusqu'à nos jours en pays haoussa, à Kano, notamment, où le Shehu Babbam Malaoui exerçait toujours en 1976.
Les cours ont lieu dans la case communale, la zaure, capable d'accueillir une trentaine d'élèves. A la manière d'Othman dan Fodio, les jeunes gens sont assis en tailleur sur des peaux de chèvre, face au maître qui trône sur un tapis.
De part et d'autre du maître s'entassent des parchemins et des copies ainsi que quelques livres imprimés en Egypte ou en Afrique du Nord. Derrière le maître, creusées dans le mur de brique crue, des niches abritent des livres précieux, d'usage rare. Devant lui, un brasier de charbon de bois répand sa chaleur et donne la cendre qui, soigneusement répandue sur le sol de terre battue, servira de tableau noir : le shehu y inscrit du bout du doigt les lettres, les chiffres et les diagrammes de sa leçon. Les élèves apprennent à l'imiter, écrivant avec une encre fabriquée à base de noir de fumée et de gomme arabique sur des planchettes de bois poli. De temps à autre, maître et élèves prennent dans une calebasse une noix de cola, leur friandise favorite.
La technique est partout la même : le maître lit une pensée, une maxime, un passage de livre ou de manuscrit. Il le commente en haoussa ou en peul. Les élèves écoutent, prennent des notes, posent — éventuellement — des questions, répètent et apprennent par coeur, mot à mot, texte et commentaires. Les étudiants d'aujourd'hui viennent de très loin pour s'instruire comme Othman dan Fodio, dans l'art de la législation et autres disciplines. A cette différence près qu'ils ont maintenant la possibilité de suivre les cours des écoles laïques.
A l'époque d'Othman, il n'en était pas question. L'école publique n'existait pas. L'instruction écrite était musulmane ou n'était pas. Et, en pays haoussa, ce sont les Foulbé qui forment l'essentiel des élèves et des maîtres.
C'est que l'islam, au XVIIIe siècle, bien qu'implanté depuis fort longtemps dans cette région d'Afrique noire, n'y est pas pratiqué avec une grande rigueur. Il bénéficie, sans doute, du prestige de la « chose écrite » . Mais les vieilles traditions animistes, le culte des ancêtres, par exemple, sont toujours vivaces dans la population, pour ne pas parler des responsables politiques qui ont tendance à oublier la doctrine sociale du Coran, la raison d'Etat passant généralement avant les principes religieux.
Devant un tel relâchement, les Foulbé, depuis toujours, se sont considérés comme les gardiens de la foi. Forts de leur science et de leurs convictions, ils prêchent en faveur d'un plus grand rigorisme et leur zèle est encore exacerbé par les récits de voyageurs qui leur racontent comment Ibrahima Sambegu, Cheikh Suleiman Bal, Abd el Kader Kane, ont renversé les dynasties païennes au Fouta-Djalon et au Fouta-Toro pour rétablir l'orthodoxie coranique.
Ils l'ignorent encore, mais c'est le début d'une révolution qui va faire de ces nomades dispersés, plus ou moins méprisés, rudement traités par les seigneurs locaux, les maîtres de la majeure partie du Soudan central. Pour sa part, Othman dan Fodio brûle de participer au combat pour la vérité. Dorénavant, qu'elle soit guerrière ou pacifique, il ne vivra que pour la jihad, la guerre sainte.
Othman dan Fodio ouvre les yeux sur le monde. Il avait passé toute son enfance et son adolescence dans la communauté foulbé musulmane de son père. Ses études l'obligent à cheminer longuement sur les pistes de la savane haoussa, de bourgade en cité. Il voit vivre les petits paysans, il partage leurs repas, il se lie d'amitié avec eux. Il lui faut constater que la majorité des Haoussa est fidèle à l'animisme et que ceux qui se prétendent musulmans ont de la religion du Prophète une idée des plus vagues.
Indiscutablement, il en souffre. Mais il refusera toujours de condamner le petit peuple, son amertume se reportant sur les seigneurs qui ne font rien pour éduquer leurs sujets.
Au demeurant, sa gentillesse naturelle lui vaut la sympathie des pauvres gens qu'il rencontre. On aime tout de suite ce garçon éveillé qui n'a pour tout bagage que la paire de pantalons, la longue blouse et le turban qu'il porte, et qui met volontiers la main à l'ouvrage — aux champs ou à l'échoppe, selon les lieux et les saisons — pour remercier d'un repas.
Convaincu que les richesses, les biens matériels de ce bas monde ne peuvent que corrompre l'âme d'un bon musulman, Othman dan Fodio, même arrivé au faite de la gloire, ne se départira jamais d'une simplicité calquée sur celle du Prophète qu'il vénère.
De la même manière, il évite, dans ses relations quotidiennes, d'abuser de la supériorité que lui donne son instruction. Il estime avoir beaucoup à apprendre du plus humble de ses compagnons de route, souvent riche de l'expérience d'une vie, de la sagesse traditionnelle.
Ce n'est qu'en matière religieuse qu'il se révèle intransigeant. Encore a-t-il la manière. Il ne se comporte jamais en inquisiteur intolérant. Il explique inlassablement, reprenant dix fois le fil de son propos jusqu'à ce que son interlocuteur comprenne.
Naturellement, les discussions atteignent un autre niveau quand elles ont lieu entre lettrés. Les amis d'Othman sont de son espèce : des parents, des condisciples, des maîtres, des missionnaires, des visionnaires qui partagent son idéal. Ils forment une communauté d'intellectuels, forts de leur certitude religieuse et très critiques à l'égard du pouvoir établi.
Dans le cas d'Othman dan Fodio, l'influence de Jibril ben Omar a été particulièrement sensible. Le maître d'Agadès, où Othman passa plusieurs mois, était un iconoclaste militant. Ses vues sur le statut des pécheurs et des infidèles étaient des plus rigoureuses : il promettait les flammes de l'enfer à ceux qui transgressaient la moindre des lois de l'Islam. Il estimait que le simple fait de fauter ravalait le pécheur au rang méprisable des païens.
Othman aura toujours le plus grand respect pour le cheikh :
— Ne me prenez pas pour un être d'exception, dira-t-il plus tard. Je ne suis qu'une vague de l'océan Jibril...
Malgré tout, il ne partagera jamais l'intolérance religieuse de son maître. Psychologue, le Shehu comprend très bien les faiblesses humaines. Son propos n'est pas de condamner les pécheurs, mais, au contraire, de les ramener dans le droit chemin. Il demeure que l'objectif des deux hommes est le même : faire respecter sur la terre haoussa la loi de l'Islam.
Une oeuvre de longue haleine. Dans le Kitab al Farq, l'un de ses écrits les plus célèbres, Othman a exposé sans complaisance les tares impardonnables des seigneurs haoussa. On peut les classer en quatre chapitres qui seraient titrés : « Oppression » , « Corruption » , « Faiblesse » , « Offenses au code de l'Islam » .
En fait, le Kitab al Farq est un cahier de doléances qui expose le programme politique — réformiste— qu'entend réaliser Othman dan Fodio.
Dans son premier chapitre, Othman reproche aux seigneurs
On notera au passage que les doléances concernant le bétail intéressent directement les Fulani. Depuis longtemps, chez eux, la révolte gronde à ce propos. En faisant connaître son point de vue de lettré, Othman dan Fodio jette de l'huile sur le feu. Et quand la guerre éclatera, ce couplet prendra une dimension historique.
L'acte d'accusation de corruption concerne, en gros, l'impossibilité d'exposer un litige au seigneur ou au juge, sans être obligé de passer par une série de fonctionnaires, qui exigent de fortes sommes d'argent pour transmettre la requête ou le dossier à leurs supérieurs hiérarchiques et qui
plaident, systématiquement, en faveur du plus riche.
Enfin, outre la faiblesse, la frivolité, la luxure des dirigeants qui vivent souvent dans des palais d'une richesse inouïe et qui s'adonnent à l'alcool, aux danses lascives, à la musique profane, Othman s'indigne du peu de cas qu'ils font de la loi, du code de l'Islam. Ainsi, ce n'est qu'un exemple, la loi sacrée exige que l'adultère soit lapidé, l'assassin exécuté, le voleur mutilé. Les seigneurs haoussa, souvent, se contentent de leur infliger des amendes ou de confisquer leurs biens. Pour un musulman aussi dévot qu'Othman dan Fodio, il s'agit là d'une attitude impardonnable parce que blasphématoire, la loi n'ayant pas été pensée par dés légistes mais dictée par Dieu.
L'impact d'un tel discours, notamment parmi les Fulani islamisés, a été considérable. Parce qu'il donne une base idéologique à leurs revendications : spécialistes de l'élevage dans des régions où la richesse s'exprime en têtes de bétail, ils supportent de plus en plus mal d'être considérés comme des sujets taillables et corvéables à merci, de ne pouvoir jouer — parce que considérés comme étrangers — aucun rôle politique ou social alors même qu'ils ont conscience de participer largement à la prospérité générale. D'où le succès des prédications d'Othman dan Fodio partout où il prêche la bonne parole. Et Dieu sait qu'il ne ménage pas ses efforts. Ses premières armes de missionnaire, il les fait à Degel, dans son propre village, qu'il regagne chaque année entre deux cours. Et chaque année, son père, le vieux Mohammed, constate avec satisfaction qu'Othman a encore gagné en savoir et en autorité sans rien perdre de sa modestie.
Il a la manière. On le trouve, chaque matin, après la première prière, assis devant la zaure, la case communale, débattant de quelque point de doctrine sous l'oeil admiratif de son jeune frère Abdullah, en compagnie des lettrés.
Les anciens sont flattés du respect qu'il leur témoigne.
Les adultes sont intéressés par les propositions qu'il avance. Les jeunes sont enthousiasmés par sa foi militante.
Ses qualités majeures sont la patience et la chaleur humaine. Personne ne le laisse indifférent. Et sa sympathie se révèle communicative au point que c'est toute l'ambiance de Degel qui en est transformée.
Sa gentillesse n'est pas une espèce de faiblesse.
Othman, s'il n'a aucune ambition personnelle, sait parfaitement faire preuve d'autorité quand il s'agit du respect de la loi islamique. Avec les femmes, en particulier, il n'hésite pas à miser sur la crédulité pour les contraindre, par exemple, à se voiler quand elles vont au marché. Il connaît leur crainte des djinns, des génies qui peuvent empoisonner la vie quotidienne d'une ménagère en faisant tourner le lait ou en gâtant une sauce. Il prévient les rebelles qu'elles seront persécutées par les djinns si elles ne suivent pas ses conseils, si elles désobéissent. Et il ne manque pas de revendiquer la moindre de leur mésaventure si cela sert sa cause. Les témoins assurent qu'il le faisait avec humour et que son autorité s'imposait sans aucune brutalité.
Tous insistent sur le fait, lui qui prétendait commander eux djinns, qu'il n'usait jamais de la crainte qu'ils inspiraient à des fins personnelles, mais au seul bénéfice de la, loi divine. Au demeurant, et c'est assez exceptionnel dans la société islamique ultra-conservatrice de l'époque, il déplorait l'ignorance dans laquelle on laissait les femmes et plaidait pour qu'elles soient instruites.
Ainsi, c'est à Degel, dans un milieu qui lui est favorable, que le Shehu entreprend sa jihad pacifique. C'est ici qu'il va recruter ses premiers disciples, s'imposer comme chef des jeunes musulmans de son clan. Où qu'il soit appelé, où qu'il décide d'aller, il restera toujours en contact étroit avec eux. Et les raisons de se déplacer, ne manquent pas.
Othman est dévoré par la foi. Il passe des heures, des journées entières sans boire ni se nourrir ni dormir, dans la plus absolue des méditations. La tradition islamique prétend qu'une fois par siècle Dieu choisit un croyant pour raffermir la foi des hommes et purifier la religion. Othman est certain qu'il est l'élu de son siècle en pays haoussa. Sa conviction est telle qu'il la fait partager à ses compagnons. Tous sont persuadés que le Shehu a une mission à accomplir. Tous sont disposés à se mettre à son service.
En 1776, il a vingt-deux ou vingt-trois ans, Othman dan Fodio prend congé de son père. Par respect pour lui, il est resté à Degel jusqu'à la fin du ramadan, mais le jeûne et la méditation n'ont fait que renforcer sa détermination : il a décidé d'aller prêcher au-delà des frontières du Gobir, et son choix s'est porté sur la principauté voisine de Kebbi.
L'Etat du Kebbi, naguère, avait été une marche du puissant empire songhai. Définitivement abattu par les Touareg au début du siècle, il ne restait de sa splendeur passée que les places fortes de Surame et de Birnin-Kebbi. Malgré tout, grâce à l'activité des marchands qui contrôlaient le commerce tout le long du Rima, un affluent du Niger, le Kebbi était resté l'une des plus prospères principautés haoussa.
Mohammed Fodio ne doute pas un instant du succès de la mission de son fils, bien qu'il sache qu'aux difficultés qui l'attendent s'ajoute un grand mal, la lèpre, qui commence à le ronger.
— Ma seule exigence, lui dit-il, c'est que tu emmènes avec toi ton jeune frère Abdullah. Il te rendra les meilleurs services et son âme se forgera à ton exemple.
De fait, le destin d'Abdullah, qui n'a pas encore quinze ans, sera désormais lié à celui d'Othman auquel, jusqu'à la fin de ses jours, il vouera une admiration sans bornes.
C'est que, d'emblée, l'adolescent est plongé dans une prodigieuse aventure.
Chargé d'un modeste bagage, un baluchon de linge de rechange, Abdullah accompagne son frère de village en bourgade, le long de la vallée sablonneuse du Rima. A chacune des haltes, il l'aide à ameuter le petit peuple des paysans et des artisans, des commerçants, des pasteurs. A tous Othman tient le même discours, dénonçant la superstition, le paganisme, les idoles et l'impiété des chefs et des seigneurs. Combattant de la foi, il va chercher ses auditeurs de case en case, les rassemble, leur promet les rigueurs de l'enfer ou les délices du paradis, enseigne les lois à respecter, les voeux à faire, les serments à prêter, les aumônes à verser.
Il est jeune, sympathique, amical, patient. Quand les villageois sont enfin réunis, il leur sourit, les salue trois fois, impose le silence, lance la formule rituelle:
« Remercions-Dieu, Seigneur de la création »
et prêche pendant des heures. Malgré sa silhouette frêle, il manifeste une telle chaleur que les plus sceptiques sont ébranlés.
Il ne quitte les lieux qu'après avoir marié les couples illégitimes, baptisé les enfants, instruit les croyants qui suivaient la mauvaise voie. S'est-il nourri, reposé ? Il a déjà repris la route d'un pas décidé, poursuivant son discours à l'intention des jeunes gens qui se joignent, à lui.
Car ils sont de plus en plus nombreux ceux qui adhèrent à l'action du Shehu, qui se convertissent, qui se transforment en disciples fervents et qui vont à leur tour battre la campagne pour y propager son nom et ses idées.
Ces disciples ne sont pas tous des Foulbé, loin de là. Othman prêche indifféremment dans sa langue, en haoussa ou en arabe, et s'adresse à tous les musulmans sans aucune distinction. Mais son discours apparaît tellement subversif, sa cible favorite restant les seigneurs, que les classes sociales les plus favorisées, nobles, commerçants et maîtres du Coran compromis avec le pouvoir, évitent de s'engager en faveur d'un mouvement sur lequel ne doit pas manquer, un jour ou l'autre, de s'abattre la répression. Les disciples d'Othman, eux, sont issus des classes les plus pauvres. Ils n'ont rien à perdre.
Et, fatalement, la réputation de sagesse, de sainteté du shehu, colportée par des dizaines de militants, amplifiée par la rumeur publique, ne tarde pas à franchir les frontières du Kebbi pour atteindre la puissante Alkalawa, capitale du redoutable Bawa, sarkin (roi) du Gobir.
Othman l'ignore-t-il ? Avant de rentrer à Degel, il prêche à travers le Konni et le Zamfara, principautés limitrophes du Gobir, où il soulève le même enthousiasme.
Sa première campagne de prédication a duré quatre années. Quand il retourne à Degel en 1782, Othman dan Fodio est un homme plein d'assurance, rompu à la vie publique, fortifié par le succès, chef incontesté du mouvement musulman réformiste. Il n'a pas trente ans. Et il ne parait pas le moins du monde impressionné par la convocation de se rendre à la cour de Bawa.
Le sarkin Bawa est alors au faîte de sa puissance. Il a fait de l'Etat de Zamfara un protectorat du Gobir et garde l'émir Abarshi prisonnier à Alkalawa. Ses troupes régulièrement, franchissent la frontière du royaume de Katsina d'où elles reviennent, invaincues, avec un lourd butin composé de marchandises, de bétail, d'esclaves. Ses succès militaires lui permettent d'entretenir une cour somptueuse de vassaux, d'alliés, de concubines, de serviteurs, de griots, d'astrologues et aussi de lettrés musulmans moins attachés qu'Othman dan Fodio à la rigueur de leur religion.
Certes, comme la plupart des seigneurs haoussa, Bawa se réfère souvent à l'islam, dont il observe certaines règles, telle la prière du vendredi. Mais son adhésion est des plus relatives pour un religieux de l'espèce d'Othman dan Fodio, qui ne tolère aucun manquement aux lois sacrées. Et quand le jeune prédicateur franchit les portes de la capitale, c'est avec la ferme conviction de convertir le prince impie.
Alkalawa est une grande ville entourée d'une imposante muraille en brique d'argile brune. Elle est cloisonnée en quartiers — corporation par corporation —, qui s'étendent jusqu'à l'enceinte qui protège, au coeur de la cité, le palais royal et les résidences des dignitaires du régime.
Othman dan Fodio est entré par la porte sud, escorté d'un groupe de talibés (disciples), comme lui vêtus de blanc et coiffés de turban.
Manifestement, il est précédé d'une flatteuse réputation, et c'est avec le plus grand mal qu'il fend la foule des curieux qui se presse, dense, autour de lui, intimidée par sa détermination et par sa simplicité : les plus effrontés touchent un pan de son boubou comme on touche un talisman.
Une fois franchis les quartiers populaires grouillants de l'activité des tisserands, des verriers, des forgerons, des tanneurs, il parvient devant le lourd portail de bois clouté qui ouvre sur la concession du sarkin du Gobir. Là, il demande à ses compagnons de l'attendre et ordonne aux gardes de l'introduire auprès du souverain.
Bawa est dans son jardin, un vaste enclos ombragé, discutant avec ses capitaines de la prochaine razzia en pays touareg. Le sarkin a sans doute été prévenu de l'arrivée d'Othman car, du plus loin qu'il le voit, il interrompt sa conversation pour l'attendre, regardant venir vers lui, avec une curiosité amusée, ce gringalet dont le fanatisme divertit la cour.
Malgré le sourire du sarkin, tout autre que dan Fodio aurait été impressionné : âgé d'une cinquantaine d'années, Bawa était un colosse dont la puissance naturelle était encore accentuée par la tenue de chasse dont il était vêtu : bottes écarlates, tunique de fine cotte de mailles, casque caparaçonné d'épais tissus. Il n'avait pas fait un pas en direction du shehu, le fixant simplement d'un regard paisible.
Othman respecte l'étiquette. Il se prosterne rapidement devant son souverain, touche sa tunique et porte la main sur son propre coeur et son front. Il ne parlera pas avant d'y avoir été invité:
— C'est donc toi, le prophète qui accomplit des miracles ? dit enfin Bawa d'une voix conciliante.
— Puissant seigneur, répond Othman, je demande à Dieu de te rendre digne de ton ministère.
Le sarkin du Gobir n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils devant une telle effronterie. Il sait son nom respecté d'un bout à J'autre du Bilal Es Soudan. Il a vaincu ses dangereux rivaux et garanti ses frontières. Honnêtement, il ne pense pas avoir démérité. Le shehu, malgré toute sa science, est encore un enfant.
— Calmons-nous, dit-il. J'agis au mieux des intérêts de mon peuple et j'assure sa prospérité. Pour le reste, je suis les traditions de mes ancêtres. L'islam est une bonne religion et j'en respecte les lois. Mais tout le monde ne peut pas vivre comme un saint.
— Tu es le maître de ce pays, s'enflamme Othman et tu dois donner l'exemple. Dieu t'a placé sur ce trône pour que tu suives sa loi et fasses régner la vraie justice.
— Les maîtres du Coran qui m'entourent, répond le prince, sont moins intransigeants que toi. Ils comprennent que la plupart de mes sujets sont attachés à leurs coutumes ancestrales. En tant que chef de notre peuple, je leur dois aussi le respect. Cela ne m'empêche pas de prier le vendredi à la mosquée.
— Puissant sarkin ! Tu dois savoir que celui qui fait la prière mais s'incline devant une idole est un hypocrite qui détruit par là mille actes de religion. Tu dois faire interdire de prier les idoles. Les rois sont faits par Dieu pour que la vérité triomphe de l'erreur.
— Les rois ne font pas toujours ce qu'ils aimeraient faire, répond doucement Bawa.
Et il est sincère. Aurait-il le désir d'obéir aux ordres du shehu qu'il ne le ferait pas sans miner la source même de son pouvoir. Ses ancêtres sont devenus rois parce qu'ils étaient réputés dominer les esprits de la terre, de l'eau, de la forêt. Il ne devait son royaume qu'à ce culte traditionnel. Pouvait-il le déclarer impie ? L'interdire ? Alors que ses sujets y croient dur comme fer ? Les vassaux l'auraient immédiatement déposé !
Pourtant, le courage et la conviction du petit shehu le font réfléchir, L'influence de dan Fodio est déjà considérable, tant au Gobir que dans les principautés voisines. Autant le ménager, ne pas s'en faire un ennemi déclaré. La vie se chargera de tempérer son caractère.
— Nous allons réfléchir à tout cela, dit-il pour conclure. Je t'autorise à prêcher autant que tu le souhaiteras et à te réclamer de ma protection. Tu peux aller.
Othman dan Fodio était à la fois déçu et satisfait. Déçu parce qu'il n'avait pas réussi à convaincre le sarkin. Satisfait parce que la protection du souverain lui permettait de faire de nouveaux adeptes — Il ressort de cela, écrivit prosaïquement son frère Abdullah, que ceux qui ne se convertissaient pas par crainte de Dieu se convertirent par crainte de désobéir au shehu, dont on connaissait les bonnes relations avec le sarkin...
Fort de l'amitié de Bawa, Othman dan Fodio se croit en sécurité. Au point de contrarier son maître en allant prêcher dans la principauté voisine de Zamfara, en dépit de la tension qui règne entre cet Etat et le Gobir.
Pendant cinq ans, de 1786 à 1791, il y déploie une fantastique activité missionnaire entrecoupée de séjours à la cour de Bawa.
Le temps n'a pas tempéré son caractère. Bien au, contraire. Il est toujours aussi intégriste, aussi ferme, aussi dynamique. Mais il pèse chaque jour davantage dans la balance politique du royaume, grâce au succès croissant de ses prédications et de celles de ses disciples parmi les populations.
Othman dan Fodio commence à se faire des ennemis jurés. Il commence à inquiéter Bawa.
Paradoxalement, les plus acharnés à sa perte sont les notables musulmans, les maîtres du Coran, compromis avec le régime. Leur hostilité relève de la « légitime défense » (Othman ne les ménage pas, leur reproche leur corruption, la tiédeur de leur foi), de la jalousie, de la politique.
Parce que Bawa ne cache pas une certaine admiration pour le meneur d'hommes qu'est dan Fodio — il lui a mérite confié l'éducation de ses fils — ses ennemis n'osent pas l'attaquer de front. Mais ils laissent planer des doutes sur l'orthodoxie de sa doctrine. Son principal détracteur est le cheikh Moustapha al-Mahir, qui lui reproche de favoriser la promiscuité entre les hommes et les femmes.
— Il serait plus agréable à Dieu, dit-il au sarkin, qui louait publiquement l'honnêteté de dan Fodio, que votre prédicateur favori harmonise ses actes et ses paroles. On voit des femmes se mêler aux hommes pour lui rendre hommage et chercher sa bénédiction, ce qui est interdit par les textes sacrés.
— Entre la négation de Dieu et le simple péché, répond le frère d'Othman, Abdullah, qui se révèle un polémiste de talent, il faut choisir le moindre mal. C'est vrai qu'il est interdit de réunir des hommes et des femmes pendant les prédications. Mais abandonner les prédications, c'est laisser ces hommes et ces femmes dans l'ignorance. Or l'ignorance engendre l'incroyance et la négation. Nous voulons leur enlever l'ignorance pour qu'ils ne soient pas des mécréants. Le Prophète recommande de parler aux hommes en tenant compte de leur niveau intellectuel et de leur milieu social. Louanges au Prophète qui nous invite à la droiture.
Bawa sourit à l'écho de ces querelles scolastiques. Il lui plaît même de s'entendre vertement reprocher sa conduite par cet homme qui pourrait être son fils. Cela le change de l'hypocrisie de ses courtisans.
— Sais-tu, lui dit-il un jour, que tu exagères ? Ne crains-tu pas ma colère ?
— Celui qui veut faire plaisir à Dieu, répond dan Fodio, n'a pas peur de blesser l'orgueil des princes d'ici-bas.
De fait, Bawa a parfois du mal à se maîtriser. En 1786, à l'occasion de la fête musulmane du Id-ahdha, celle du dixième mois, alors que le shehu et nombre de ses disciples sont réunis à Alkalawa, on rapporte à Bawa que dan Fodio prêche la désobéissance à ses édits.
— Ici ! dans ma propre capitale ! Chez moi !
Fou de rage, le roi se rend, seul, dans la concession qu'occupe le shehu et ses compagnons avec la ferme intention de châtier l'impudent. Veut-il le tuer ? Quand il se trouve en présence de dan Fodio et de ses disciples, leur nombre le fait hésiter. Il demeure debout, silencieux, la main crispée sur le manche de son poignard. L'un de ses courtisans, témoin de la scène, comprend la situation :
— A l'exception de Dieu, dit-il, personne ne peut faire ici ce que tu as projeté.
Bawa retrouve son sang-froid. Et quand Othman dan Fodio lui demande tranquillement ce qui lui vaut l'honneur de la présence du souverain, Bawa répond que son intention était de lui offrir un troupeau de cinquante têtes de bétail.
— Dieu te rende grâce de ta générosité, répond le shehu, mais tu peux garder tes troupeaux. Les musulmans te demandent le seul droit de propager leur foi, celui de pouvoir occuper des emplois dans l'administration, moins d'impôts pour les paysans et la libération de tous les prisonniers zamfara, y compris leur chef, Abarshi. Tu peux, puissant sarkin, nous l'accorder.
Surpris, Bawa accorda.
L'exigence concernant la libération d'Abarshi, prisonnier de Bawa depuis de nombreuses années, est particulièrement significative. Officiellement, Othman dan Fodio était un sujet du sarkin
du Gobir. En fait, le shehu se souciait moins des frontières que du Coran. Pour lui, l'Islam était le ferment politique qui permettrait aux hommes de créer une société digne de la pureté originelle de la foi, une société juste. Il ne défendait ni les intérêts de Bawa, ni ceux du chef Abarshi. Il ne prenait parti ni pour les Peuls, ni pour les Haoussa, ni pour les Touareg. Il prenait parti pour les croyants, pour les musulmans, et c'est précisément parce qu'il transcendait les particularismes locaux que son mouvement était révolutionnaire, menaçait l'ordre établi et recueillait l'adhésion des couches les plus défavorisées — mais les plus nombreuses — de la région.
Maintenant, Bawa ne pouvait plus en douter.
Conscient de la puissance que représente maintenant Othman dan Fodio, le sarkin du Gobir essaye par tous les moyens de l'attacher à ses intérêts, lui proposant même de devenir son cadi, c'est-à-dire le juge suprême du royaume.
Mais le shehu est assez fort pour refuser toute compromission, sans craindre pour sa vie. Il est devenu le chef incontesté d'une internationale de musulmans réformistes. Il parcourt tout le Soudan central, prêchant, formant des disciples, avant de s'installer à Degel où il ouvre un centre d'études.
Il y constitue le centre nerveux d'une puissante communauté de fidèles, la Jama'a, dont il est le directeur spirituel, le cheikh, et c'est là qu'il enseigne à des étudiants enthousiastes, accourus de toute part, le droit, la grammaire, la rhétorique et qu'il rédige, outre les pamphlets les plus mordants, des poèmes en langues haoussa et fulfuldé.
Il continue d'entretenir, malgré tout, des relations courtoises avec Bawa, qui le consulte régulièrement. Mais entre les deux hommes le courant ne passe plus, et ces relations resteront formelles jusqu'à la mort du souverain.
Au demeurant, cette mort témoigne du peu de cas que faisait Bawa des avis du shehu, si l'on en croit le Raud al Jinân (« les Pâturages du paradis » ) de Malam Gidado, l'un des disciples et biographe d'Othman dan Fodio :
« Quelque temps après l'affaire du Id-al-adha, raconte-t-il, Bawa convoqua le shehu à propos de la campagne contre la ville de Maradi, qui lui résistait outrageusement.
Le shehu avait rejoint l'armée du Gobir sous les murs de la ville. Il y avait là au moins dix mille hommes, divisés en divers corps, nobles cavaliers montés sur des chevaux lourdement caparaçonnés, fantassins armés de lances et de boucliers en peau, archers parés de plumes. Installé au pied d'un baobab, botté d'écarlate comme le jour de sa première rencontre avec dan Fodio, le sarkin du Gobir recevait les rapports de ses officiers et donnait des ordres.
Il avait déjà le pied à l'étrier quand le shehu put enfin s'approcher de lui. Bawa aimait la guerre. Il était resplendissant sous l'éclat du soleil :
— Que penses-tu de cette journée, lança-t-il en souriant à Othman. Que disent les étoiles ?
— Puissant sarkin, répondit le shehu, elles disent que tu auras la victoire avant d'avoir chaussé les étriers mais que Dieu t'interdit, aujourd'hui, de te mêler au combat.
Bawa le guerrier partit d'un grand rire, comme s'il venait d'entendre une plaisanterie. Accompagnée du roulement des tabalas, des tambours de guerre, la première vague d'assaut, couverte par les tirs des archers, s'élançait vers la forteresse.
La première prédiction d'Othman se révéla exacte. Incapables de tenir plus longtemps Maradi devant une aussi formidable armée, les troupes rebelles l'abandonnèrent pour se regrouper en brousse et trouver refuge à Tsibiri, ville voisine distante d'une vingtaine de
kilomètres. Bawa n'avait pas eu le temps de se mettre en selle que ses hommes étaient maîtres de la place, où ils accumulaient un riche butin.
Pour le sarkin, il n'était pas question de laisser l'armée ennemie faire sa jonction avec celle de Tsibiri.
— Nous avons vu ce qu'a fait le shehu à Maradi, dit-il. Voyons ce que peuvent faire nos lances!
Malgré la désapprobation de ses officiers, témoins de la prédiction d'Othman, le sarkin mena la charge contre les fuyards et trouva une mort glorieuse après avoir rompu six lances. »
Cela se passait en l'an 1204 de l'Hégire (1790). Othman dan Fodio avait trente-six ans.
A Bawa avait succédé son frère Yakuba, qui ne régna que quatre années.
Quatre années pendant lesquelles Othman dan Fodio accrut encore son audience parmi les peuples des principautés de Gobir, de Zamfara, de Kebbi, poussant, à l'ouest, jusqu'aux cités du Niger, Illo par exemple, retournant à Degel, repartant battre encore la campagne où l'appelaient des âmes à raffermir, des communautés à instruire.
Le nouveau sarkin du Gobir respectait les avantages acquis par Othman dan Fodio sous le règne précédent, mais, sans être particulièrement tendues, les relations entre les deux hommes ne dépassèrent jamais le stade de la courtoisie.
Aussi bien, il est curieux de constater que Yakuba eut sensiblement la même fin que son frère, ainsi que la rapporte la chronique des « Pâturages du paradis » .
Consulté à propos de l'attaque de la ville de Magami, Othman dan Fodio déconseilla au sarkin une telle entreprise. Il dépêcha auprès du souverain son propre neveu, Kaumanga, pour qu'il renonce à son entreprise, et Yakuba allait fléchir quand ses courtisans lui firent remarquer que l'attitude du shehu n'était pas forcément celle d'un sage, mais celle d'un partisan qui profite de son influence pour protéger ses coreligionnaires assiégés dans Magami.
De fait, se plaçant au-dessus des partis, Othman dan Fodio comptait des amis dans les deux camps et souhaitait éviter une bataille fratricide. Soucieux de sa gloire et de la puissance de son royaume, Yakuba se rangea finalement à l'avis de ses courtisans et dépêcha un messager pour en aviser le shehu.
Quand l'envoyé du souverain arriva à Degel, Othman dan Fodio l'écouta attentivement et répondit par l'une de ces formules énigmatiques dont il avait le secret :
— Yakuba, dit-il simplement, ne retournera jamais chez lui, si Dieu le veut, mais, si Dieu le veut, tu retourneras chez toi.
La prophétie, une fois de plus, se révéla exacte Yakuba fut tué à Magami.
Le successeur de Yakuba, son frère cadet Bunu Nafata, n'avait pas l'intention de s'en laisser conter par le prophète lépreux. En cette année 1795, date de son couronnement, il pouvait considérer sans exagération la puissance morale d'Othman dan Fodio comme une menace réelle pour son autorité. Sous le règne de ses deux frères il avait assisté à l'irrésistible ascension du shehu. L'affaire de Magami, où Yakuba avait trouvé la mort, l'avait convaincu que les musulmans réformistes n'étaient pas de loyaux sujets et que, s'il ne réagissait pas tout de suite, son trône même serait en danger. Son exaspération atteignit son paroxysme quand on lui rapporta que les nomades foulbé refusaient de payer la taxe sur le bétail parce que « païenne » .
— La vue même de ces fanatiques m'est insupportable ! hurla-t-il à ses conseillers.
Mais les conseillers de Bunu Nafata le pressaient de ménager dan Fodio :
— Seigneur, répondirent-ils, le shehu est considéré comme un saint, même par vos sujets qui ignorent sa religion. Le toucher serait considéré comme un acte sacrilège.
— Je n'ai pas besoin de toucher à lui. Qu'est-ce qu'un chef privé de guerriers ? Qu'est-ce qu'un guerrier privé de ses armes ? Un lion édenté. Un lion privé de ses griffes. J'ai décidé de priver le lion de ses dents et de ses griffes. Et s'il relève la tête, je n'hésiterai pas à la lui faire trancher!
Burin Nafata était excédé. On saurait bientôt qui de lui ou de dan Fodio régnait sur le Gobir.
Dès le lendemain, des messagers quittaient la concession royale. Montés sur de puissants coursiers, ils avaient mission de faire connaître les ordres du souverain dans les villages les plus isolés du pays.
Partout, les messagers du roi réunissaient , les habitants pour leur faire connaître les décisions royales. Sous peine de mort, il était interdit aux enfants d'abandonner la religion de leurs frères et les nouveaux convertis devaient se rétracter. Enfin, le port du voile, pour les femmes, du turban, pour les hommes, était interdit sur l'ensemble du territoire,
Cette dernière mesure n'était pas fortuite, insignifiante, mais politique : le souverain du Gobir l'était de droit divin. Il était le chef religieux de son royaume. Il était mandaté par les esprits pour régner à leur place.
De leur côté, les musulmans considèrent que l'imam, le chef religieux de leur communauté, est aussi le chef de l'Etat. Ainsi, chaque sujet païen qui se convertissait à l'Islam niait implicitement l'autorité du sarkin et se plaçait sous celle de l'imam, en l'occurrence Othman dan Fodio. Il n'avait même pas à le proclamer. Le simple fait de porter le voile ou le turban était assez éloquent. Et depuis que le shehu avait entrepris son oeuvre missionnaire, voiles et turbans s'étaient considérablement multipliés. Au point que le souverain n'avait qu'à porter son regard sur la foule un jour de marché pour comprendre que ses sujets lui échappaient.
En interdisant aux musulmans de vivre leur foi, en leur interdisant de prêcher par l'exemple, en les empêchant de porter leurs signes distinctifs, Bunu Nafata espérait les réintégrer dans son royaume.
Malgré tout, Bunu Nafata avait dû faire une exception de taille. L'interdiction de prêcher s'adressait à tous les musulmans, sauf à Othman dan Fodio. Il connaissait l'homme. Il le savait assez convaincu, assez courageux pour endurer tous les supplices. Il savait qu'aucun édit n'aurait pu lui barrer le chemin qu'il s'était
tracé. Pour éviter le soulèvement général qu'auraient provoqué l'arrestation et l'exécution du shehu, le sarkin, s'il lui interdisait de faire école, l'avait autorisé à prêcher, parmi ses coreligionnaires.
En fait, les édits du souverain du Gobir n'eurent pas du tout l'effet escompté. Ils provoquèrent, au contraire, un plus grand militantisme de la part des musulmans.
L'épreuve de force tournait à la confusion de Bunu Nafata.
Le sarkin fit une ultime tentative pour vaincre dan Fodio : il fit emprisonner les membres de sa famille et somma le shehu de mettre un frein à ses activités s'il tenait à la vie des otages.
La nouvelle parvint à Othman dan Fodio alors qu'il rentrait à Degel après une longue tournée de propagande dans la région de Gwandu. Le messager qui était venu à sa rencontre lui avait raconté l'affaire d'une traite :
— Ils ont emmené ton épouse Aïsha et ton frère Abdullah. Ils ont pris ton frère Koiranga et ton oncle Abdullah-Qadir. Ils les ont enchaînés comme des esclaves et leur ont fait prendre la route du Gobir. Que Dieu leur vienne en aide
Othman ne répondit pas. Plongé dans ses méditations, il poursuivit sa route au pas lent du cheval. Arrivé à Degel, il écarta la foule des fidèles venus a sa rencontre et ne mit pied à terre que devant la case communale. Là, il s'accroupit et resta plusieurs jours dans cette attitude, priant, murmurant des paroles inaudibles, ignorant les calebasses de nourriture que lui apportaient les femmes. Après une semaine de méditation, il se releva, commanda son cheval et prit à son tour le chemin du Gobir, en retenant d'un geste de la main ceux des hommes qui voulaient l'accompagner.
On le vit ainsi partir avec consternation, chacun s'attendant à ne plus le revoir. On essaya une dernière rois de le retenir:
— Je viens de m'agenouiller devant le trône de Dieu, dit-il simplement, et je n'ai rien à craindre de Bunu Nafada.
Plus tard, on racontera que, pendant sa semaine de méditation, ordonnée par Dieu, il avait été transporté jusqu'au paradis par des anges ; que le cheikh Abd-el-Qadir l'avait pris par la main (« le Seigneur de toute création l'attestera un jour » ) et qu'il avait dit aux anges : « cet homme m'appartient » ; qu'il avait été introduit dans le saint des saints et que le Créateur des hommes et des djinns avait ordonné à Abd-el-Qadir de lui donner un nom qu'il serait le seul à porter et que ce nom était l'« Imam de tous les saints » .
Bunu Nafata n'était pas disposé à entendre la légende. Il entendait exiger d'Othman dan Fodio qu'il mette fin à ses activités. Cela faisait maintenant six années qu'il régnait et, loin d'avoir regagné le terrain perdu par ses prédécesseurs, il avait chaque jour un nouveau témoignage du succès de la révolution silencieuse du shehu.
Introduit dans le palais royal par Yunfa, le propre fils de Bunu Nafata, qui avait été, enfant, son élève, Othman s'avança vers le sarkin sans éviter son regard. Le souverain se leva brusquement de son trône, ouvrit la bouche comme pour lancer un ordre, grimaça, porta la main à sa nuque et s'écroula inanimé.
— Ton père, dit simplement Othman au jeune Yunfa, va mourir. Si Dieu le veut, c'est toi qui régneras.
De fait, la prophétie allait se révéler exacte. Bunu Nafata avait été transporté chez lui et ses médecins ne purent le sauver. Il mourut d'une tumeur maligne à la nuque. Son fils, grâce à l'appui des partisans d'Othman dan Fodio à la cour, fut choisi pour lui succéder de préférence à l'un de ses cousins, héritier présomptif.
Cela se passait en l'an 1218 de l'Hégire (1803). Le fait qu'Othman ait pu prévoir la mort prochaine de Bunu Nafata laisse penser qu'il était depuis longtemps au courant de la maladie qui rongeait le souverain haoussa. Le fait qu'il ait pu influencer le conseil des nobles au point d'imposer Yunfa comme nouveau roi témoigne de la qualité de ses partisans. En vérité. Othman dan Fodio comptait maintenant des amis et des disciples dans toutes les couches de la société du Gobir.
Le nouveau sarkin était déchiré. Son affection et son estime pour son ancien précepteur — sans parler de la reconnaissance qu'il lui manifestait — ne font aucun doute. La chronique rapporte que Yunfa se rendit seul, à pied, jusqu'à Degel rendre hommage à son maître. De la part du souverain le plus puissant de la région, c'était là un acte d'humilité qui tranchait avec l'attitude de ses prédécesseurs.
Mais, comme ses prédécesseurs Bawa, Yakuba et Bunu Nafata, Yunfa ne pouvait tolérer la menace que représentait la communauté musulmane.
Un premier conflit éclata entre Yunfa et dan Fodio à propos d'une petite communauté musulmane conduite par l'un des disciples du shehu. Abdu Salami, qui, fuyant les persécutions religieuses, avait décidé d'émigrer au Gobir pour se fixer avec ses troupeaux à Gimbana, dans l'Etat voisin — et vassal — du Kebbi.
Courroucé, Yunfa ordonna aux fugitifs de rentrer au Gobir. Abdu Salami refusa et, pour châtier les rebelles, Yunfa lança une expédition militaire contre Gimbana.
La ville fut enlevée après un bref combat, rasée, et les survivants de la communauté musulmane furent emmenés au Gobir pour y être réduits à l'état d'esclaves. Malheureusement pour les soldats de Yunfa, la route du Gobir passait par Degel, le fief d'Othman dan Fodio.
Le prophète, selon la tradition populaire, se porta au-devant de la longue troupe de captifs :
— La condition d'esclave, dit-il au commandant de l'armée du sarkin, ne sied pas à de bons musulmans.
Et sans attendre la réponse du militaire, il entreprit de libérer les captifs de leurs liens.
Devant une telle assurance — mais aussi conscient de la menace que faisaient peser sur son escouade les guerriers de Degel qui maintenant le cernaient —, le soldat laissa Othman dan Fodio délivrer ses coreligionnaires.
Quand Yunfa apprit l'affront qui venait d'être infligé à son autorité, il entra dans une violente colère et décida d'en finir une fois pour toutes avec le « porteur de turban » .
Il convoqua dan Fodio, qui se rendit à l'invitation, mais dès qu'il fut en sa présence, le souverain se saisit de son mousquet, le braqua dans la direction du shehu et pressa la détente.
Le coup ne partit pas. Un miracle avait transformé en sable fin la poudre de la cartouche...
— Degel, dit le sarkin, sera châtié comme l'a été Gimbana. Puisque Dieu t'épargne, je te promets de mettre ta propre famille à l'abri. J'ai dit.
— Je n'abandonnerai jamais ma communauté, répliqua dan Fodio d'une voix posée. Mais la terre de Dieu est vaste et nous allons quitter ton pays.
— Je t'ordonne de rester ! s'emporta le souverain.
Le shehu ne répondit pas. Sa décision était prise.
De retour à Degel, Othman dan Fodio ordonna immédiatement l'exode. La jihad, la guerre sainte, était inévitable. Cela se passait le 21 février 1804. Le shehu lépreux avait cinquante ans.
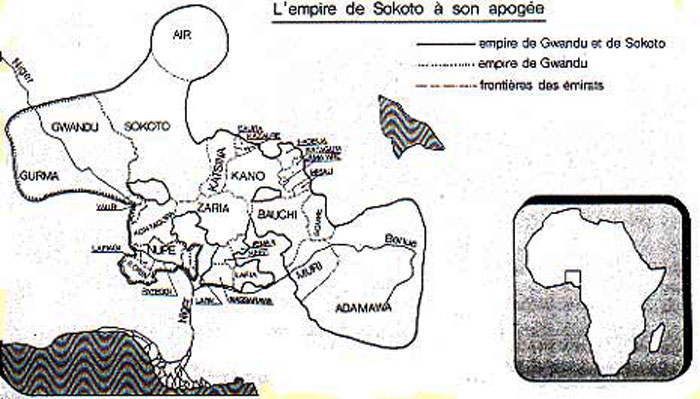
Qui pourrait deviner qu'ils sont sur le point de fonder un empire ? Comme le prophète qu'il vénère, Othman dan Fodio cherche le refuge dans la fuite. Il est accompagné de son frère Abdullah, de son fils Mohammed Bello, de ses fidèles, les talibés. Ils ont emmené avec eux leurs familles, leur bétail, leurs armes, leurs livres, un peu de nourriture et quelques objets personnels., Ils ont abandonné Degel et font retraite en direction du soleil couchant, vers l'ouest.
L'ouest. Déjà, Degel était à l'ouest du Gobir et le Gobir à l'ouest du pays haoussa. La course du shehu amène sa communauté à traverser une immensité désertique, sauvage, de sable, de rocaille, d'épineux. Les rares oasis de fertilité qu'ils rencontrent permettent au bétail de s'abreuver, aux hommes de se reposer. L'une de ces oasis abrite une bourgade nommée Gudu. Othman dan Fodio décide d'y installer les siens. Située sur un promontoire, la petite cité domine les larges plaines stériles. Les musulmans sont à l'abri de toute surprise d'où que vienne le danger, un nuage de poussière trahira les armées de Yunfa.
Pour l'heure, le jeune souverain du Gobir ne donne aucun signe de vie. Pourtant, la nouvelle du départ d'Othman dan Fodio s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Et de tout le royaume, les musulmans accourent maintenant vers Gudu pour se mettre aux ordres de leur shehu. En vain Yunfa leur interdit de quitter leur foyer. En vain il ordonne que soient confisqués les biens des déserteurs. En vain les patrouilles sont multipliées pour intercepter ceux qui n'ont pas renoncé à rejoindre les rebelles.
Pendant deux mois, Yunfa va se contenter de demi-mesures. Manifestement, il redoute un soulèvement général des communautés musulmanes auxquelles pourraient se joindre les principautés vassales et d'ambitieux voisins. En mai, il fait savoir au shehu qu'il lui accordera son pardon pour peu qu'il se soumette.
Othman dan Fodio n'est plus disposé à passer de compromis. Il répond à Yunfa qu'il ne retournera pas à Degel à moins que Yunfa ne se repente de ses péchés, moralise ses méthodes de gouvernement, rende les biens qu'il a confisqués et embrasse la vraie foi.
Le roi est mis au pied du mur. Il convoque ses conseillers et les lettrés du royaume pour leur demander qui du shehu ou du sarkin est dans son droit. Tous sont d'accord pour dire que la justice est du côté de Yunfa.
— Dans ce cas, ordonne le souverain, qu'un messager se rende à Gudu pour dire au shehu que je vais le combattre et qu'il se tienne prêt pour notre rencontre.
La solennité de cette déclaration de guerre n'ébranla pas la détermination des musulmans réfugiés à Gudu. Simplement, ils pensèrent qu'ils allaient bientôt mourir et ils décidèrent de mettre de l'ordre dans leurs affaires.
« Nous décidâmes, écrivit Bello, le fils et successeur d'Othman dan Fodio, de nous donner un chef et nous finies tous allégeance au shehu. Nous promîmes d'obéir a ses ordres et de le suivre tant dans la fortune que dans l'adversité. Il accepta notre hommage et il jura de suivre le Livre et la Loi. Cet événement eut lieu dans la soirée du mercredi. Le premier à lui rendre hommage fut son frère, le waziri Abdullah, puis ce fut mon tour, puis celui d'Uwuru Mai-Alkammu, enfin celui de tous les musulmans. »
Pour la première fois. Othman dan Fodio était investi du titre de Commandeur des Croyants. Un titre qui, en pays haoussa, avait toujours été porté (Sarkin Musulmi) par les sultans de la principauté de Sokoto. La rupture était totale avec le Gobir, mais de toute évidence le shehu avait peu de chances de porter son titre très longtemps tant la situation semblait désespérée.
Bien que la position stratégique de Gudu fût intéressante, la place, qui n'était pas une forteresse, se révélait indéfendable. En outre, son territoire était trop pauvre pour nourrir longtemps la dizaine de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'y étaient réfugiés. Enfin, alors que Yunfa, souverain du plus puissant des royaumes haoussa, pouvait aligner une armée de près de cent mille hommes, renforcée par dix mille cavaliers, et un corps de mousquets, dan Fodio, sans forteresse, sans argent, sans vivres, ne disposait que de quelques milliers d'hommes mal armés et d'une vingtaine de cavaliers.
Mais ces hommes étaient d'une trempe peu commune : ils croyaient en leur cause, ils savaient être les instruments de la volonté divine et ils ne craignaient pas la mort.
Vers la fin du mois de mai 1804, Othman dan Fodio réunit ses fidèles sur la place de la bourgade. A les voir aussi déguenillés, la pitié lui serra le coeur et, un instant, il se demanda s'il ne devait pas renoncer. Mais leurs yeux brillaient d'une telle confiance, d'une telle volonté, qu'il comprit dans un éclair que la communauté irait jusqu'au bout de son destin
— Que la volonté de Dieu soit faite ! lança-t-il brusquement. Cette jihad sera cruelle mais elle vous ouvrira à jamais les portes du paradis. De cela nous pouvons être sûrs, car le Prophète nous a armés d'une épée capable de vaincre les plus grandes armées de la terre, et cette épée, c'est l'épée de Vérité.
Galvanisés, les guerriers musulmans se levèrent en brandissant leurs armes, bénissant le nom d'Allah, et le shehu sut qu'il ne fallait plus attendre.
Aussitôt après, il confia à Mohammed Gayar, l'un des rares musulmans versés dans l'art de la guerre, le soin d'organiser l'armée :
— Nous n'avons plus une minute à perdre, lui dit-il. Yunfa doit avoir levé toutes ses troupes et fondra sur nous avant les pluies, dans moins d'un mois. Nous pourrions éviter le combat et marcher encore en direction du soleil couchant, niais nous risquons d'être pris à revers par les seigneurs de Giniga et de Matankari.
Mohammed Gayar était un homme dans la force de l'âge, pieux, discret, raisonné. Aussi, quand il répondit :
— Je ferai bâtir une mosquée à Giniga et à Matankari, personne ne douta qu'il était assez fort pour enlever ces deux cités.
Trois jours plus tard, Mohammed Gayar quittait Gudu à la tête d'une petite armée de cinq mille hommes. Quand il fit ses adieux au shehu, sa voix était ferme :
— Aie confiance, dit-il simplement à dan Fodio. Nous reviendrons plus forts que nous ne partons.
— Dieu ne peut pas nous abandonner, répondit le shehu. Que Sa volonté soit faite.
La première campagne militaire était lancée.
Les musulmans bénéficiaient de l'effet de surprise. Personne ne pouvait imaginer qu'ils oseraient prendre l'initiative d'attaquer.
Une semaine plus tard, Mohammed Gayar était de retour à Gudu, victorieux, accompagné d'une longue colonne de porteurs chargés d'un butin d'armes, de vivres et, surtout, d'une centaine de chevaux caparaçonnés pour la guerre.
Ses pertes en hommes n'étaient pas négligeables mais elles se trouvaient largement compensées par l'afflux de volontaires musulmans qui, enthousiasmés par la bravoure de leurs coreligionnaires, s'étaient joints aux vainqueurs.
Giniga, Matankari, du point de vue militaire, n'étaient pas des victoires décisives. Mais elles démontraient la valeur des guerriers musulmans et la propagande des partisans du shehu, dans tout le Gobir, allait s'en emparer et renforcer la détermination des réformistes.
A Gudu, Mohammed Gayar, après un repos de quelques jours, profita de l'exaltation de ses hommes pour convaincre Othman dan Fodio de conserver l'initiative.
— Il semble, dit-il, que Yunfa n'ait pas encore réuni son armée. Profitons-en pour briser ses alliés alentour. Je propose d'enlever Birnin Konni !
— Le sarkin du Gobir risque d'être aussi rapide que toi, objecta le shehu. Konni ne se rendra peut-être pas aussi facilement que Giniga oui Matankari. Ne serait-il pas plus sage de laisser les guerriers panser leurs blessures ?
Bello, qui assistait à l'entretien, prit la parole
— Père ! Laisse-nous aller. Nous sommes armés de l'épée de Vérité. Nous sommes faits d'un autre métal que nos ennemis.
Le shehu sourit. La maladie l'empêchait de porter les armes, mais il savait de quelle trempe étaient ses fidèles.
— Vous partirez mercredi, dit-il. Mais si la ville résiste, n'insistez pas.
— Elle ne résistera pas, affirma Mohammed Gayar.
Birnin Konni était distante d'une cinquantaine de kilomètres. C'était une cité entourée d'une importante muraille en pisé, défendue par une garnison aussi forte que toute l'armée musulmane. Le siège risquait de durer longtemps et, l'armée de Yunfa aidant, de tourner au désastre.
— L'ennemi n'aura pas le temps d'organiser sa défense, promit Mohammed Gayar.
Il devait tenir parole.
La colonne musulmane quitta Gudu dans la soirée du mercredi. Les 50 kilomètres furent couverts dans la nuit. A l'aube, Konni était investie. Toute la journée du jeudi, malgré l'avalanche de flèches des défenseurs, les guerriers de Mohammed Gayar s'attaquèrent aux remparts de la ville. A 5 heures, une brèche fut enfin ouverte et, une heure plus tard, la garnison se rendait
Les musulmans allaient célébrer leur victoire quand Mohammed Gayar et Bello furent avertis que le sarkin du Gobir attaquait Gudu.
Le chef musulman rassembla immédiatement ses troupes, ordonna de lever le camp et entreprit une nouvelle marche forcée vers Gudu, où ils arrivèrent à J'aube du vendredi.
L'information était fausse Yunfa n'avait pas encore quitté Gobir, Mais le fait d'armes de l'armée musulmane, une armée sous-équipée, composée de volontaires sans expérience, sans entraînement, sans discipline, est des plus exceptionnels. En trente-six heures, malgré la chaleur torride, ces hommes avaient parcourir 100 kilomètres à pied, assiégé une ville, et gagné une bataille :
— Ce jour-là, dit simplement Bello, nous avons connu les limites de l'endurance.
Le mois de juin était arrivé et, avec lui, les premières pluies. Dans son palais du Gobir, Yunfa était d'humeur morose. Il avait appris la chute de Giniga et de Matankari, maintenant de Birnin Konni, sans y attacher une trop grande importance mais il était irrité par le refus poli des souverains voisins qu'il avait invités à se joindre à lui pour la promenade militaire qu'il entreprenait.
Ces renforts n'étaient pas nécessaires au sarkin du Gobir pour vaincre la poignée de rebelles qui prétendaient bafouer son autorité. Son invitation courtoise de faire partager à ses voisins les plaisirs de la guerre comme on invite à un festin était un geste d'estime et d'amitié. Leur refus était ressenti par le souverain comme un geste d'hostilité. Même le royaume vassal de Zamfara, à l'exception de la cité de Gummi, s'était refusé à ses obligations.
En vérité, on le craignait trop pour ne pas se réjouir de ses difficultés, et les seuls à avoir rejoint son camp étaient les chefs touareg, qui ne redoutent personne et sont toujours disposés à en découdre sous quelque prétexte que ce soit.
Déçu dans son amour propre, Yunfa était maintenant pressé d'en terminer avec une affaire qui ne pouvait rien ajouter à sa gloire. Il ordonna à ses vassaux de se mettre en route avant que les pluies ne rendent les pistes impraticables et les campements trop inconfortables.
La fine fleur de la chevalerie gobirawa était rassemblée au Gobir, plusieurs centaines de nobles accompagnés de leurs griots, de leurs épouses, de leurs guerriers, de leurs sorciers, de leurs tambours. La ville était en ébullition, au grand plaisir des commerçants qui vendaient aux seigneurs de la soierie par coupons, des bijoux d'or et d'argent et des vivres par tonnes.
Tous, y compris les épouses, devaient accompagner l'armée, bien décidés à ne pas perdre le moindre épisode du spectacle que le sarkin du Gobir leur offrait. Tous étaient convaincus — l'hypothèse contraire n'effleurait mérite pas les esprits — qu'à la seule vue de cette magnificence la bande rebelle prendrait une fuite honteuse.
C'était la seule inquiétude de Yunfa, soucieux de ne pas laisser échapper le gibier, et cette inquiétude détermina sa stratégie : l'armée gobirawa devait prendre la route de l'ouest, contourner Gudu et rabattre les musulmans vers le centre du pays d'où ils ne pourraient plus s'échapper, pris dans la nasse. Et quand enfin les soldats du roi levèrent le camp, bannières au vent, quand la terre se mit à gronder sous les sabots des milliers de chevaux, quand un énorme nuage de poussière obscurcit la plaine, il ne fit aucun doute que le sarkin n'allait faire qu'une bouchée des porteurs de turbans.
L'armée de Yunfa s'était ébranlée le 7 juin. Au pas lent des équipages, elle mit quinze jours avant d'atteindre, à 30 kilomètres à l'ouest de Gudu, les rives d'un petit lac appelé Tabkin Kwatto.
Dans le camp musulman, ce n'est pas sans angoisse que les plus courageux des guerriers suivaient de leur promontoire l'avancée du flot ennemi dans la plaine. Nombre d'entre eux pensaient que la sagesse imposerait au shehu d'éviter le contact avec un aussi formidable adversaire.
Ce n'était ni l'avis de Mohammed Gayar, ni celui de Bello, ni celui d'Abdullah, ni celui d'Othman dan Fodio.
— A quoi bon éviter le combat ? avait dit le shehu. Un jour ou l'autre nous devrons quitter la terre de Dieu. Si Dieu le veut, nous mourrons ici même.
— Si Dieu le veut, répliqua son frère Abdullah, nous vaincrons sur les rives du lac Tabkin Kwatto.
Mohammed Gayar, dont le courage n'était pourtant plus à démontrer, ne put cacher sa stupéfaction :
— Tu prétends, dit-il incrédule, que nous devons aller au-devant de l'armée du sarkin du Gobir ?
— Allah m'est témoin, je ne suis pas devenu fou, répliqua Abdullah, Regarde les païens. Vois comme ils sont grisés par leur puissance. Ont-ils la force de monter à cheval ? Je les vois vêtus d'étoffes précieuses, vautrés sur d'épais coussins avec leurs courtisanes, s'empiffrant de viande et de mil, ivres d'orgueil et de débauche. Ils n'ont pas un regard pour nous. Allons jusqu'à leur camp. Portons-y le fer et le feu. Ne leur laissons pas le temps de caparaçonner leurs chevaux.
Le plan d'Abdullah était d'une telle audace qu'il laissa les chefs militaires sans voix.
Et brusquement. Mohammed Gayar éclata de rire
—Tu as raison. Par le ciel, tu as cent fois raison. Je ne sais pas si nous vaincrons, mais si nous devons périr, que cela soit à notre manière, en braves.
Le shehu lui-même fut gagné par le rire.
— Mon frère, dit-il enfin, c'est le Prophète qui t'inspire. Si nous attendons ici, nous provoquerons le massacre de nos épouses et de nos enfants. Si nous acceptons une bataille rangée dans la plaine, la cavalerie de Yunfa nous taillera en pièces, nous qui n'avons même, pas de piques ! Et son infanterie nous tombera dessus comme un nuage de sauterelles. Ne leur laissons aucun répit !
Ce soir du mercredi 20 juin 1804, les guerriers musulmans furent invités à se préparer en silence. Dans la nuit, ils franchirent les 30 kilomètres qui séparaient Gudu du lac Tabkin Kwatto. A l'aube, ils avaient atteint le lac.
Ils laissèrent aux Gobirawa un bref répit, le temps de se désaltérer, de faire leurs ablutions, d'abreuver les chevaux, de prier.
L'alerte avait été donnée dans le camp du sarkin du Gobir et l'armée du souverain commençait à se déployer, en désordre, occupant l'entrée d'une petite vallée pour permettre à la cavalerie lourde de prendre son élan.
Normalement, les musulmans, inférieurs en nombre, et en armement, auraient dû préparer une bataille défensive, à partir de positions solides. Mais rien dans leur comportement n'était normal. Ils étaient simplement, venus pour mourir les armes à la main. Ils quittèrent l'abri des arbres du bord du lac, formèrent trois corps d'armée, les fantassins des ailes gauche et droite, encadrant les archers, et marchèrent sur leurs ennemis.
Protégés par leurs boucliers, leurs cottes de maille, leurs armures capitonnées, leurs mousquets, leurs lances, leurs sabres, les guerriers du roi du Gobir attendaient le choc avec confiance.
Soudain, les musulmans lancèrent par trois fois leur cri de guerre, Allah Akbar ! et chargèrent. Aussitôt répondirent les tambours du roi et une salve de mousquets, par chance tirée de trop loin. A son tour, l'infanterie gobirawa s'élança à la rencontre des hommes de dan Fodio.
Ils étaient si nombreux, face à la phalange musulmane, que les ailes gauche et droite des fous de Dieu, pressées, se retrouvèrent soudées en carré autour du corps des archers qui poursuivait son avance dans la masse.
Ils auraient dû être anéantis, sabrés par la cavalerie adverse, achevés par les fantassins égorgeurs. Mais complètement encerclés par l'infanterie royale, qui empêchait la cavalerie d'intervenir efficacement, ils résistaient à tous les assauts, décochant au contraire des traits meurtriers aux cavaliers qui essayaient vainement de se frayer un passage jusqu'à leurs lignes.
Si miracle il y eut, ce fut celui du courage et de l'endurance. A un contre dix, jusqu'au soir, les musulmans taillèrent en pièces chaque vague de l'armée gobirawa, fonçant au coeur des régiments ennemis jusqu'à ce qu'ils se disloquent.
A la nuit tombante, c'est Yunfa qui ordonna en personne la retraite ; il avait perdu l'essentiel de sa cavalerie et les deux tiers de son infanterie : trente mille hommes, trois mille chevaux. Rarement l'histoire militaire avait enregistré un tel désastre.
« Ce fut, raconta Bello, la plus belle bataille de la jihad. Le Seigneur brisa l'armée ennemie jusqu'à ce qu'elle se débande et nous les anéantîmes dans leur course... Nous les talonnâmes et fîmes un grand massacre. Dieu seul sait combien nous en avons tué ! Nous ne nous sommes arrêtés qu'à la nuit, quand il fut l'heure de la prière du soir, l'heure de rendre grâce à Dieu, Seigneur de la Création. Cette victoire fut aussi miraculeuse que celle de Badr, qui vit le Prophète écraser les païens de La Mecque. »
Pour sa part, le shehu n'avait plus aucun doute : il était sur terre l'instrument de Dieu.
La défaite du sarkin du Gobir à Tabkin Kwatto retentit comme un coup de tonnerre dans tout le pays haoussa. Les souverains qui craignaient sa puissance, les petits rois qui avaient été forcés de reconnaître sa suzeraineté se réjouirent du succès d'Othman dan Fodio et se félicitèrent de ne pas s'être mêlés à ce conflit.
Mais parmi ceux qui étaient ravis de la leçon donnée à l'orgueilleux Yunfa, nul n'avait reçu la nouvelle avec, autant de plaisir que les souverains du Zamfara.
Le Zamfara, naguère, avait été un Etat puissant, respecté de tous. Pourtant, depuis deux générations, il ne restait pratiquement plus rien de sa splendeur passée. Vaincu par les Gobirawa, le vieux royaume de Zamfara avait été rabaissé au rang de protectorat. La capitale, rasée, n'avait pas été reconstruite. Les parties nord et ouest du pays avaient été annexées au Gobir et si les princes des quelques cités préservées étaient encore « indépendants » , ils le devaient par-dessus tout à leur soumission au sarkin du Gobir, auquel ils payaient un lourd tribut annuel.
Aussitôt connue la victoire de Tabkin Kwatto, les princes de trois grandes cités du Zamfara, Bakura, Talata Mafara, Bukwium, proposèrent une alliance à Othman dan Fodio.
Le shehu accepta avec joie.
Il ne doutait pas du caractère providentiel de la bataille du lac. Mais il savait aussi que la guerre était loin d'être gagnée ; Yunfa avait les moyens de se ressaisir. Sa puissance avait à peine été entamée. Il pouvait encore lever une, deux armées aussi redoutables que celle qu'il avait alignée à Tabkin Kwatto.
En revanche, si leur victoire avait sauvé les musulmans de l'extermination, nombre d'entre eux, dont Mohammed Gayar, avaient connu une mort glorieuse sur le champ de bataille. Et ce n'était pas à Gudu, où l'on avait le plus grand mal à trouver sa propre nourriture, que le shehu pouvait les remplacer. L'alliance des princes du Zamfara lui ouvrait les plaines fertiles au confluent des fleuves Rima et Sokoto. Il pourrait recruter de nouvelles troupes et faire la jonction avec Mohammed Moyijo, un Fulani musulman de ses amis qui tenait fermement la ville de Yano et toute la région alentour, à l'est du Zamfara.
Enfin, Othman dan Fodio donna le signal du départ. Maintenant, la colonne de ses fidèles n'avait rien de comparable avec celle des exilés qui s'étaient réfugiés, suivant la course du soleil, de Degel à Gudu. Les guerriers, ces femmes, ces enfants étaient plus pauvres, plus maigres, plus fatigués, si possible, mais ils étaient des vainqueurs et cela se voyait à leur port altier, à la flamme qui brillait dans leurs veux.
Leur transhumance se fit sous les pluies lourdes du mois de juillet.
Elle les conduisit jusqu'à l'actuelle Sokoto (Nigeria) où le shehu établit son campement et reconstitua ses forces en prévision des durs combats qu'il n'ignorait pas devoir engager dès le retour de la saison sèche.
Pendant ces quelques semaines de répit, il passa le plus clair de son temps sous sa tente, rédigeant d'une écriture élégante de longues lettres destinées aux souverains haoussa dont il espérait le secours. Il leur expliquait pourquoi il avait dressé sa bannière contre le sarkin du Gobir.
— Notre combat, disait-il, est celui de la vérité contre le mensonge et je vous conjure de vous joindre à nous...
Chaque jour, des messagers entraient dans sa tente, en ressortaient avec un parchemin et, sans attendre, chaussaient les étriers pour une course périlleuse de plusieurs centaines de kilomètres.
Othman ne s'impatientait jamais. On ne voyait sa silhouette frêle drapée de blanc qu'aux heures des prières, et la tranquille confiance qui émanait de sa personne rassurait la communauté.
Pourtant, le temps passait. Et nulle réponse ne venait des souverains sollicités de la manière la plus pressante. Unie seule fois, le shehu manifesta son amertume :
— Ils se prétendent musulmans, dit-il à son frère Abdullah, mais leur foi est aussi hypocrite que l'amour de leurs courtisans.
La vérité était plus brutale. S'ils n'aimaient pas le sarkin du Gobir, s'ils se réjouissaient de ses difficultés et s'ils souhaitaient la ruine de son royaume, les rivaux de Yunfa, eux aussi des féodaux, n'avaient pas la moindre sympathie pour la cause réformiste. Ils ne considéraient pas l'action de dan Fodio comme une jihad.
Ce n'était, pour eux, que la révolte de manants contre leur seigneur légitime, une insurrection fulani contre le pouvoir haoussa. L'aspect religieux de la question était considéré comme un simple prétexte. Ils attachaient une plus grande importance à l'aspect ethnique et politique. A l'exception des princes des trois cités du Zamfara et des Touareg de l'Adar et de l'Air — mais ces turbulents nomades étaient davantage intéressés par le butin de victoire que par la réforme —, aucun des souverains haoussa ne s'engagea dans la Jihad.
A la fin du mois d'octobre, quand les pluies cessèrent de fertiliser la savane, Othman dan Fodio savait qu'il ne pourrait compter que sur ses propres forces et que la guerre ne cesserait qu'après que l'une ou l'autre des parties aurait été écrasée.
Le shehu confia l'organisation de la nouvelle campagne militaire à son frère Abdullah, investi du titre de waziri (vizir). Il avait le commandement du premier corps d'armée, le second étant sous les ordres de Bello.
Depuis la victoire de Tabkin Kwatto, les guerriers musulmans n'étaient pas loin de se croire invincibles. Les dépouilles des ennemis tués leur avaient procuré un équipement abondant, de qualité, et leur troupe était grossie des contingents touareg et zamfara ainsi que de nombreux Fulani expulsés de la principauté haoussa de Katsina.
— Nous pouvons en finir une fois pour toutes avec Yunfa, dit Abdullah. Et nous irons le chercher chez lui, à Alkalawa. Nous enlèverons les uns après les autres tous les villages qui entourent la capitale et, le moment venu, nous donnerons l'assaut au repaire du sarkin du Gobir.
Chacun avait en mémoire les formidables protections d'Alkalawa. L'épais mur d'enceinte, haut de 10 mètres, lisse comme la peau, percé de meurtrières, surmonté de créneaux, dominait de toute sa masse un large fosse comblé de branches de sarkakkiya, un arbuste aux longues épines. L'entreprise était aussi folle que la charge suicidaire de Tabkin Kwatto.
Et c'est pourquoi le plan d'Abdullah fut adopté.
— Vous engagerez la campagne dès la nouvelle lune (novembre) avec toutes nos forces, décida le shehu. Pendant ce temps, je constituerai une armée de réserve pour le cas où vous auriez besoin de renforts. Dieu nous conduira à la victoire et le Gobir sera purifié des idoles.
Le 3 novembre 1804, l'armée musulmane franchissait la frontière du Gobir. Le 16, la première phase de l'opération était réalisée : Yunfa, l'orgueilleux souverain du plus puissant royaume haoussa, était assiégé dans sa capitale.
Le 18, Abdullah et Bello ordonnèrent l'assaut. Ce fut un combat acharné, sans merci, et Bello écrivit à son frère que « l'armée des croyants fut à deux doigts de pénétrer dans la ville. Pendant la bataille, nous avons tué un grand nombre d'ennemis et beaucoup de nos hommes ont aussi trouvé le martyre » .
Le revers musulman devant Alkalawa était grave. Et ses conséquences devaient être encore pires. Déçus de n'avoir aucun butin à se partager, les Touareg furent les premiers à déserter. Pour eux, la cause était entendue : jamais l'armée du shehu ne pourrait enlever la place. Et pour mettre un comble à leur trahison, les hommes du désert attaquèrent et pillèrent tous les campements fulani qu'ils rencontrèrent dans leur fuite.
Fou de colère, Abdullah commit l'imprudence de se lancer à leur poursuite sans attendre l'armée de réserve, conduite par Othman en renfort.
Bello, au demeurant malade, était chargé d'assurer le siège de la capitale. Il n'en avait pas les moyens et les Gobirawa, conscients de sa faiblesse, décidèrent d'engager le combat en rase campagne.
Le choc des deux armées se produisit à Tsuntsuwa, un hameau distant de deux kilomètres de la ville. Trois colonnes de fantassins gobirawa, appuyés par un millier de cavaliers, se ruèrent sur les musulmans formés en carré. Malgré leur courage, les croyants, au fil des heures, commencèrent à perdre pied.
— Serrez les rangs ! Serrez les rangs ! Allah Akbar!
Monté sur un étalon blanc, armé d'un sabre, Bello se défendait comme un lion. Il vit tomber à ses côtés le cadi Mohammed Sambo, qui n'avait pas son pareil pour arbitrer un différend de justice, mais il n'eut pas le temps de le secourir : il devait se porter à l'aide de Sa'adou, le porte-bannière, qui succombait sous une grappe d'ennemis. Bello frappa vingt fois avant de sauver l'oriflamme vert des mains des infidèles. Mais il savait que la bataille était perdue et que, sauf miracle, aucun des siens n'assisterait à la prière du soir.
Le miracle eut lieu. Dans le fracas et la fureur de la mêlée, personne n'avait entendu le son des tambours de guerre. Dans la poussière de l'après-midi qui leur masquait jusqu'au soleil, aucun des combattants musulmans n'avait vu arriver l'armée levée par Othman dan Fodio.
Ils se rendirent compte qu'un événement venait de se produire quand ils sentirent la pression de l'ennemi se relâcher puis les Gobirawa refluer en ordre vers la cité comme s'ils avaient soudain décidé d'accorder leur grâce à la poignée de rescapés, toujours groupés autour de Bello.
Il n'était pas question de les poursuivre. Tous étaient épuisés. Les musulmans avaient perdu deux mille de leurs meilleurs hommes, dont deux cents uléma réputés pour leur piété et leur savoir. Ils n'avaient que la satisfaction de pouvoir enterrer leurs morts.
Le bilan de la campagne de novembre était décourageant. Il se soldait par la rupture de l'alliance avec les Touareg et par la perte du meilleur tiers de l'armée musulmane. D'autre part, le shehu n'avait pas conquis de territoire et dépendait toujours de la bonne volonté des princes du Zamfara. Enfin, la défaite de Tsuntsuwa avait complètement effacé le prestige acquis à Tabkin Kwatto.
Au contraire, le sarkin du Gobir avait tout lieu d'être satisfait. Il avait lavé l'humiliation du lac et, dorénavant, il pourrait compter sur l'appui des souverains haoussa, qui avaient compris que l'espoir de se débarrasser de leur dangereux voisin était vain et qui ne manqueraient pas de voler au secours d'une victoire facile.
En fait, l'échec musulman devant Alkalawa allait prolonger la jihad de quatre longues années.
Il ne restait plus à Othman dan Fodio qu'à retourner sur le territoire de ses alliés zamfara pour y panser ses blessures. Il installa son campement à Sabongari, dans la haute vallée du Gawan Gulbi, la rivière morte, où il reçut des renforts de volontaires dont ceux d'Ousouman Masa, membre de la famille royale du Kebbi, brouillé avec son souverain.
Le royaume de Kebbi était situé à l'ouest du Zamfara, à cheval sur le fleuve Rima, un affluent du Niger. C'était un pays riche, peuplé de vigoureux paysans, où les réformistes comptaient de nombreux partisans.
— Si tu me donnes l'émirat de Kebbi, proposa Massa au shehu, je serai à jamais ton vassal.
Othman dan Fodio n'hésita pas longtemps. Il sentait que la présence de ses troupes en pays Zamfara irritait la population locale et que ses propres exigences politiques à l'égard des princes étaient reçues avec de moins en moins d'enthousiasme. Un renversement d'alliances n'était pas à exclure et, dans ce cas, la situation militaire des réformistes serait devenue tragique.
Othman confia à son frère Abdullah et à Ali Jédo — qu'il venait de nommer chef d'état-major — le soin d'organiser la campagne contre le royaume de Kebbi tandis que Bello devait rester pour tenir les troupes du Gobir en respect et défendre, éventuellement, Sabongari.
Cette décision allait se révéler particulièrement opportune.
Abdullah et Jédo, à leur habitude, menèrent l'offensive avec décision : l'armée s'ébranla le 8 mars 1805, dans la chaleur torride qui précède la saison des pluies. A marches forcées, la colonne musulmane arriva devant la ville de Gummi, l'une des rares cités zamfara restées fidèles au sarkin du Gobir, l'enleva pour protéger ses arrières et franchit la frontière du Kebbi.
Le 12 avril suivant, à peine un mois après leur départ de Sobongar, les troupes d'Abdullah avaient enlevé d'assaut toutes les places fortes qui protégeaient la capitale. Le siège de Birnin Kebbi commençait.
Les combattants l'ignoraient, mais du succès de l'opération dépendait le sort de la jihad. Au matin du 12 avril, Bello avait apporté au shehu une nouvelle stupéfiante : les princes zamfara avaient rompu l'alliance ! Sur tout leur territoire, les détachements fulani étaient attaqués :
— Tout le Zamfara s'est insurgé contre nous, expliqua-t-il calmement. Les Zamfarawa reprochent à nos hommes de se conduire comme en pays conquis et nous devons admettre qu'ils n'ont pas absolument tort. Les nouvelles recrues, frère, n'ont ni la discipline ni la sagesse des vétérans de la première heure. Les Zamfarawa n'ont plus confiance ni en nous ni en notre cause. Ils nous considèrent comme des oppresseurs.
— Tu connais la situation, répondit le shehu de sa voix douce. Nous n'avons nul endroit pour abriter nos femmes et nos enfants. Brise la rébellion des renégats zamfara. Nous n'avons pas su les maintenir dans l'alliance par l'amitié, Nous devons les y contraindre par la crainte que tu sauras leur inspirer. Que Dieu nous pardonne. Trop de ses fervents fidèles sont tombés dans les combats qu'ils ont livrés pour Sa gloire. Mais nous ne pouvons pas perdre un territoire avant d'en avoir conquis un autre.
Les ordres du shehu étaient clairs, et Bello les exécuta sans complaisance. En l'espace de deux mois, il rasa quinze villes ou bourgades et les campagnes alentour. Les princes du Zamfara avaient fait la preuve de la tiédeur de leur foi. Les Haoussa devaient comprendre une fois pour toutes que les Fulani ne pardonnaient pas.
Malgré tout, Othman dan Fodio ne pouvait plus maintenir son quartier général à Sabongari. Heureusement pour lui, l'armée commandée par Abdullah et Jédo avait enlevé Birnin Kebbi d'assaut. Certes, le souverain légitime du royaume, Mohammed Hodi, était parvenu à s'échapper vers le nord, où il possédait plusieurs places fortes, mais l'essentiel du Kebbi, dont la capitale, qui livra un butin jamais égalé au cours de la jihad, était entre les mains des réformistes.
Comme promis, Othman dan Fodio installa Masa à la tête de l'émirat. Ce n'était en fait qu'une clause de style. Par droit de conquête, le shehu était le véritable maître de l'un des principaux royaumes haoussa.
Pendant que les réformistes réduisaient la rébellion zamfara et menaient à bien la conquête du Kebbi, le sarkin du Gobir, Yunfa, n'était pas resté inactif. Il avait obtenu des autres souverains haoussa, maintenant inquiets pour leurs propres royaumes, une alliance militaire qui se traduisait par l'envoi à Alkalawa de contingents d'archers et de cavaliers, et par l'étroite surveillance des musulmans auxquels il était interdit de quitter leur lieu de résidence sous peine de mort. Il pouvait également se flatter d'avoir rangé à ses côtés les turbulents Touareg, les seigneurs zamfarawa et le sarkin légitime de Kebbi, toujours retranché dans le nord de son pays.
Ces forces déjà considérables s'ajoutaient à sa propre armée et Yunfa n'attendait plus que la fin de la saison des pluies pour briser les partisans d'Othman dan Fodio.
De fait, le danger d'extermination des réformistes était aussi grand qu'à l'époque de la bataille de Tabkin Kwatto. A cela près qu'ils ignoraient tout de ce qui les attendait, aucun de leurs sympathisants n'ayant pu franchir les lignes. A cela près que leur cohésion, l'affaire de Zamfara l'avait révélé, n'était plus aussi ferme.
Au début du mois de novembre 1805, après la saison des pluies, le sarkin du Gobir donna à ses armées l'ordre de marcher sur l'ennemi. Othman dan Fodio avait installé son quartier général à Gwandu. Il s'attendait si peu à l'événement qu'il avait envoyé une colonne assiéger la ville d'Augi, fidèle à l'ancien souverain de Kebbi, tandis que d'autres troupes musulmanes étaient dispersées à travers le Zamfara et le Kebbi.
Othman eut encore la chance d'avoir décidé d'investir Augi. Les forces royales longeaient le fleuve Rima, et la ville se trouvait sur leur passage. Quand les assiégeants prirent conscience du fabuleux déploiement militaire qui fondait sur eux, ils levèrent le camp et se replièrent en toute hâte sur Gwandu.
Prévenus par un coursier, les chefs militaires musulmans s'étaient réunis pour décider de la tactique à adopter. Abdullah et Jédo penchaient pour une offensive, comme cela leur avait si parfaitement réussi jusqu'à présent. Bello n'était pas de cet avis:
— Yunfa, dit-il, a sans doute retenu la leçon que nous lui avons infligée à Tabkin Kwatto. Quand bien même il n'aurait rien compris, la situation géographique n'est pas la même. Au bord du lac, les collines ne favorisaient pas les charges de la cavalerie. Si nous allons au-devant du sarkin du Gobir, il pourra la déployer dans la plaine. Je refuse de courir un tel risque.
— Allah m'est témoin, répliqua Abdullah, de l'estime que j'ai pour ton courage. Je dis que mourir ici ou là n'a aucune importance quand il s'agit de servir la gloire de Dieu. Mais je prétends qu'il faut se surpasser pour mériter qu'Il daigne nous accorder la victoire. Seuls les hommes repus de biens matériels songent, les fous, à se protéger.
Bello ne répliqua pas à l'injure. Il portait à son oncle un trop grand respect pour laisser fuser des paroles cinglantes.
— Si vous persistez dans votre erreur, dit-il, vous le ferez sans moi.
L'erreur majeure, répondit Jédo, serait de diviser nos forces alors que l'ennemi n'est qu'à deux journées de marche.
Le shehu n'avait pas pris part à la conversation. Il savait déléguer ses pouvoirs politiques et militaires. Pourtant, l'affaire prenait de telles proportions que les trois chefs de guerre sollicitèrent spontanément son avis :
— Tu dois accompagner tes frères, Bello, dit-il simplement. Notre unité est une grande force.
Bello se résigna. De mauvaise grâce. Mais il ne voulait pas qu'il fût dit un jour que la bataille avait été perdue parce qu'il avait refusé de se porter au-devant de l'ennemi.
Malgré tout, Abdullah savait reconnaître ses erreurs. Son tempérament impulsif le poussait à commettre des imprudences, mais s'il avait le temps de réfléchir il n'hésitait pas à se reprendre. Ainsi, alors qu'il chevauchait à la rencontre du sarkin du Gobir, il commença à reconnaître la valeur des arguments de son neveu. La plaine s'étalait à perte de vue et chaque cavalier sentait des fourmis dans ses éperons. En face, les seigneurs Gobirawa et leurs alliés devaient jubiler.
Abdullah se porta à la hauteur de son neveu.
— Bello, lui dit-il, nous courons un trop grand danger. La cavalerie ennemie va fondre sur nos archers comme une armée de sauterelles et nos lanciers n'auront pas le moindre point d'appui pour s'arc-bouter et les arrêter. C'est toi qui avais raison. Retournons à Gwandu.
Bello remercia son oncle.
— J'ordonne à mes hommes de s'arrêter et de rebrousser chemin. Nous pouvons être de retour avant la nuit
La colonne de Bello, immédiatement, manoeuvra, bientôt suivie par celle de son oncle Abdullah. Mais, en première ligne, les fantassins et les cavaliers d'Ali Jédo poursuivaient leur progression. Dans le camp musulman, la confusion était totale. Elle fut encore aggravée par la décision de Jédo de respecter le plan initial.
En désespoir de cause, Abdullah et Bello durent reprendre leur marche en avant.
Le désaccord entre leurs chefs de guerre affecta la discipline et le moral des troupes. Dans les rangs, les guerriers s'irritaient de ces marches et contremarches qui leur était imposées alors qu'ils souffraient de la chaleur, de la soif, de la fatigue et qu'il leur faudrait bientôt combattre une armée qui les surclassait en hommes et en matériel.
Tout de même, quand ils arrivèrent à proximité de Kwolda, une bourgade neutre où le shehu comptait de nombreux sympathisants, ils se réjouirent à l'idée qu'ils allaient pouvoir reposer leurs jambes et se désaltérer.
Il n'en était pas question. La colonne menée par Ali Jédo défila sous les remparts de la cité, sans s'arrêter, à la grande déception de ceux qui les suivaient. Et l'irritation des soldats d'Abdullah, parmi lesquels se trouvaient beaucoup de nouvelles recrues, atteignit son comble quand il frappa du plat de son sabre un homme qui était sorti du rang pour boire à la jarre d'une porteuse d'eau.
Le soldat injuria Abdullah, qui répliqua. L'altercation n'avait pas duré plus de deux minutes, mais ce fut suffisant pour que les moins disciplinés rompent les rangs pour aller boire.
Stupéfait, Bello vit les guerriers commandés par son oncle se disperser. Les hommes, maintenant, couraient vers la porte de Kwolda, et Abdullah, pris à parti par un groupe agressif, ne pouvait plus rien faire pour les arrêter.
Bello se porta imprudemment au secours du vizir, laissant ses propres hommes à leur seule initiative. Et sa colonne, à son tour, rompit les rangs pour se joindre aux mutins.
Il fallut trois heures aux deux chefs de guerre et aux vétérans pour rétablir l'ordre. Mais quand ils y parvinrent, la cité de Kwolda avait été entièrement pillée.
Abdullah et Bello avaient les meilleures raisons d'être inquiets. Leur autorité avait été bafouée et ils se demandaient avec angoisse quel serait le comportement de leurs hommes face à l'armée du sarkin du Gobir.
— Nous allons à un désastre, constata Abdullah. Maintenant, nous devons rentrer à Gwandu pour protéger le shehu. L'armée doit être purifiée de ses mauvais éléments si nous voulons que le Seigneur de toute création demeure à nos côtés.
— Comment veux-tu qu'Il protège une bande de pillards sans foi ? Son châtiment sera à la mesure de nos péchés.
— Nous devons rentrer à Gwandu.
Dans la soirée, l'armée musulmane campa en vue de la ville d'Alwasa. Abdullah et Jédo avaient rejoint Bello sous sa tente.
— Nous ne pouvons plus reculer, dit Ali Jédo gravement. L'armée du sarkin du Gobir est en face de nous. Elle vient d'arriver à Alwasa.
Le choc eut lieu au lever du jour, et les musulmans, raconte Bello, « y lavèrent leurs péchés dans leur sang » .
Pour la première fois dans l'histoire de la jihad, les guerriers du shehu ne surent pas justifier leur réputation de discipline et de courage. Les Touareg avaient enfoncé l'aile gauche, commandée par Abdullah, tandis que les charges de la cavalerie ennemie décimaient en vagues successives les fantassins de Jédo.
Seule la valeur du carré des vétérans de Bello évita aux musulmans de perdre non seulement la bataille, mais la guerre. Malgré de très lourdes pertes, plus d'un millier d'hommes, ils résistèrent toute la journée, interdisant ainsi aux cavaliers gobirawa de se lancer à la poursuite des fuyards.
Pour les musulmans, la bataille d'Alwasa se soldait par un désastre. Et le sarkin du Gobir jubilait. Toute la nuit, à la lueur des torches et des feux, son camp retentit des chants et danses de victoire. Gwandu, il le savait, n'était protégée par aucune fortification, et le shehu n'avait d'autre choix que de périr au combat ou de chercher son salut dans une fuite honteuse.
Pour aller où ? Quand il le voudrait, Yunfa enlèverait Gwandu, libérerait tout le Konni. Dan Fodio n'aurait même pas la possibilité de trouver refuge, comme après sa tentative contre Alkalawa, en pays zamfara ! Il était perdu.
Cela, Bello ne l'ignorait pas. A la faveur de la nuit, démoralisé, il faisait retraite, imposant à ses compagnons fourbus une ultime longue marche. Il avait rejoint Abdullah et Jédo et les trois hommes encourageaient les rescapés de leur armée à resserrer les rangs, tant leur crainte était grande de voir surgir à l'aube les cavaliers haoussa, inévitablement lancés à leur poursuite.
Mais, à l'aube, la plaine ne retentit pas du cri de guerre des cavaliers du sarkin du Gobir. Confiant dans la suite des événements, Yunfa n'avait pas saisi l'occasion d'exterminer les débris de l'armée musulmane, d'enlever Gwandu, de châtier le shehu rebelle.
Ce répit dura cinq jours, pendant lesquels la communauté musulmane affronta la plus grande crise de son histoire.
Sa position, déjà désespérée, était encore aggravée par la défection du pitoyable Ousmane Masa, placé par dan Fodio à la tête du royaume de Kebbi. Lui aussi, convaincu de la fin prochaine du shehu, venait de négocier sa soumission au sarkin du Gobir et s'était placé, avec ses troupes, sous ses ordres.
Les deux premiers jours, samedi et dimanche, les fidèles du shehu semblèrent comme résignés au sort qui les attendait. Leur maître était plongé dans une méditation profonde et seuls ses plus intimes familiers avaient la faculté de l'approcher.
Le premier à se ressaisir fut encore Bello.
— Qu'attendons-nous ? demanda-t-il. Nous devons purifier l'armée avant d'espérer la réorganiser. Allons-nous nous laisser égorger comme des moutons ?
Ce ne fut ni lui, ni le bouillant Abdullah, ni le redoutable Jédo qui rendirent le moral à leurs hommes mais le frêle shehu, tellement détaché des affaires de ce monde qu'il se bornait à approuver les décisions des chefs militaires et politiques d'un mot ou d'un signe de la tête.
Bien que la cause musulmane fût avant tout la sienne, il n'entendait pas s'écarter d'un pouce du strict rôle de directeur de conscience, de chef spirituel de sa communauté. Et le lundi, tout de suite après la prière du matin, il s'adressa aux fidèles.
« Le shehu, raconte Bello, sortit de la mosquée et prêcha devant le peuple. Avec amour, il les exhorta à chasser de leur tête toute pensée impure et à suivre la voie de la justice. Il pria pour que Dieu nous donne la victoire et son discours enflamma les âmes les plus tièdes. »
Il était temps. Deux jours plus tard, les premiers éléments de l'armée du sarkin du Gobir commençaient à se masser devant Gwandu.
Le miracle eut lieu à Gwandu. En l'espace d'une semaine la cause musulmane bascula des berges de la ruine à celles du triomphe absolu.
Gwandu n'avait aucune fortification. Mais la cité avait été bâtie sur une colline en pente douce et cette pente était comme pavée de larges blocs de pierre.
La configuration du terrain favorisait les assiégés dans la mesure où elle rendait périlleuses les charges de la cavalerie lourde. En revanche, l'infanterie adverse, si supérieure en nombre qu'elle paraissait couvrir toute la plaine, pouvait raisonnablement espérer l'enlever d'assaut.
Les assiégés devaient vaincre ou connaître le martyre. Ils ne pouvaient plus s'enfuir : Gwandu était coupée du monde extérieur par le cercle compact des troupes du Sarkin du Gobir et de ses alliés.
Yunfa et ses pairs, imprégnés de leur orgueil féodal, ne voulaient pas laisser aux fantassins le mérite de la victoire, ils entendaient se réserver la part du roi.
Ainsi, pendant deux jours, la noblesse haoussa s'usa dans des charges brisées par les archers fulani.
De fait, Abdullah, Bello et Jédo avaient converti en archers tous les hommes valides. Ils massacrèrent une bonne partie de la cavalerie royale. Les combattants zamfarawa tentèrent de faire leur jonction avec ce qui restait de l'armée du sarkin du Gobir. Interceptés par une colonne fulani dans la vallée du fleuve Rima, ils y furent exterminés et leur défaite livra le Zamfara au shehu.
Pendant l'automne de l'année 1806, les musulmans franchirent la frontière du Gobir. Ils avaient retenu la leçon d'Alkalawa. Commandés par Ali Jédo, ils n'essayèrent pas d'enlever la capitale de Yunfa, se contentant de soumettre villes et villages les uns après les autres, et ruinant systématiquement les régions qu'ils ne pouvaient pas contrôler.
Cette action, qui avait pour objet l'affaiblissement du sarkin du Gobir (et qui fixait ses troupes autour d'Alkalawa), permit aux partisans du shehu de s'emparer du pouvoir dans l'émirat de Katsina.
Ce dernier succès, obtenu au début de l'année 1807, achevait l'encerclement du Gobir.
Yunfa ne pouvait même plus compter sur l'aide extérieure des souverains haoussa de Kano et de Zazzau, eux-mêmes réduits à la défensive. Pendant encore un an, les musulmans hésitèrent pourtant à l'attaquer dans sa capitale. Ils organisaient leur victoire, laissant mûrir le fruit, et ce n'est qu'au mois de novembre 1808 que fut prise la décision d'en finir :
— L'orgueil du sarkin du Gobir, dit un jour Abdullah au shehu, est brisé. Si Dieu le veut, nous planterons sa tête sur une pique le jour que nous souhaiterons. Nous contrôlons tout le pays. Nous l'avons vaincu quand nous étions si peu nombreux que notre bravoure devait valoir celle de dix guerriers. Nous sommes aujourd'hui plus puissants qu'il ne l'a jamais été. Je te demande l'honneur de mener l'ultime assaut.
Les deux frères étaient seuls. Othman dan Fodio hésita avant de répondre, puis enfin demanda:
— Selon toi, Abdullah, qui me succédera? Qui poursuivra mon oeuvre ?
Surpris, le vizir répondit
— Bello, bien sûr ! A quarante ans, son expérience est celle d'un vieux sage, sa piété est celle d'un imam, son courage... Qui pourrait oser se prétendre son rival ?
Othman sourit à son frère :
— Je crois que tu as beaucoup d'indulgence pour ton neveu. Mais tu as raison de dire qu'il est digne de poursuivre notre oeuvre. Nous pouvons faire beaucoup pour sa jeune gloire en lui confiant le commandement suprême de l'armée qui enlèvera Alkalawa.
Abdullah ne put s'empêcher de sourire. Il reconnaissait de bon coeur que son frère avait raison.
— Cela m'apprendra à pécher par orgueil, dit-il. Rien ne m'aurait autant satisfait que de tuer de ma propre main le sarkin du Gobir. Veux-tu me le pardonner ?
— Ton courage n'est plus à démontrer, Abdullah. Je suis fier de toi comme du meilleur des fils aînés.
Au mois de novembre 1808, Bello, investi du commandement suprême, mettait le siège devant Alkalawa.
« Dieu, écrit-il sobrement, nous ouvrit les portes de la ville. En un clin d'oeil, les croyants se précipitèrent sur l'ennemi, les tuèrent ou en firent des esclaves. Yunfa périt ainsi que ceux de son entourage. Que Dieu en soit remercié. »
La légende rapporte que le messager dépêché pour annoncer la grande nouvelle au shehu n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche:
— Je sais ce que tu viens me dire. Dieu m'en a déjà averti.
Menées par Abdullah, Bello ou Ali Jédo, les colonnes musulmanes enlevèrent les uns après les autres tous les royaumes haoussa, à l'exception du lointain Bornou. Othman dan Fodio s'était installé à Sokoto, et cet empereur sans courtisans, sans trône, sans palais, distribuait les bannières d'émirs comme des récompenses à chacun selon ses mérites.
Il vivait dans la simplicité qui avait été la sienne depuis son plus jeune âge. Son seul luxe était le temps qu'il consacrait à la rédaction de lettres qu'il échangeait avec des hommes de condition aussi différents que le sultan du Maroc, les théologiens de l'Université du Caire ou les marabouts de villages perdus sur la carte. La rigueur le conduisait à des polémiques sans fin dans lesquelles il se complaisait, pour son plus grand plaisir intellectuel. Il n'est aucun exemple au monde comparable à celui du fondateur de l'empire fulani de Sokoto, empereur aux pieds nus.
Othman dan Fodio, déjà miné par la lèpre, tomba gravement malade en 1816, à l'âge de soixante-quatre ans. Les remparts qui entouraient sa capitale venaient d'être terminés et, la veille, à la demande de Bello, il les avait bénis.
Pendant l'année que dura sa maladie, il continua à écrire et à prêcher, mais de toute évidence il n'avait plus beaucoup de temps devant lui tant son visage se creusait et sa silhouette s'amenuisait.
Sa succession soulevait un problème, de nombreux musulmans considérant qu'Abdullah, le plus ancien collaborateur du shehu, devait lui succéder. Mais il était normal, et c'était la volonté d'Othman, que le titre de Sarkin Musulmi (commandeur des croyants) échût à Bello, par respect de la règle d'hérédité.
Le troisième jour du mois de Jumada al-Ukhra, sixième mois de l'année islamique (20 avril 1817) le shehu rendit son dernier soupir. Il fut enterré aux côtés de son épouse Hawa, et sa tombe est encore aujourd'hui le but d'un pèlerinage que font les musulmans dans toute cette partie de l'Afrique.
Bello fut donc intronisé Sarkin Musulmi — l'absence d'Abdullah avait facilité les choses —, mais l'empire fut divisé en deux parties d'importance sensiblement égale : Abdullah, qui avait pris le titre d'émir de Gwandu, régnait sur les principautés jadis haoussa de
Théoriquement, il était l'égal de Bello, en puissance, mais le fils du shehu, outre l'autorité morale que lui conférait le titre de Sarkin Musulmi, régnait sur
et était suzerain des royaumes de
La division de l'empire portait en germe tous les conflits qui allaient le détruire, peu de temps avant l'invasion coloniale britannique. Bello régna vingt ans, avec sagesse, mais ses successeurs ne surent pas préserver l'idéal de justice qui avait motivé l'action du shehu et de ses compagnons.
En revanche, parmi le peuple haoussa, il a raffermi par son exemple — et la légende s'y est ajoutée — la foi musulmane. Une foi qui a survécu aux vicissitudes de l'Histoire et, qui transmise de génération en génération, a fini par être un facteur des sentiments nationaux nigérians, nigériens et camerounais pendant les heures sombres de la colonisation.